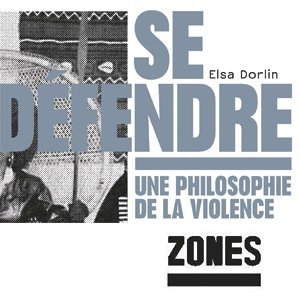Littérature et féminicide – sur « 2666 » de Roberto Bolaño
J’ai lu jusqu’à ce jour deux fois les 1 012 pages de 2666. Une première fois dans l’ordre et puis une deuxième fois dans le désordre ou plutôt dans un autre ordre, en commençant par la cinquième partie du roman, puis en relisant la quatrième puis en reprenant la première jusqu’à la troisième. J’en ai lu aussi de très nombreux fragments en espagnol. Car l’espagnol de Bolaño est très beau, très simple, d’une grande fluidité. « En diciembre, y éstas fueron las ùltimas muertas de 1996, se hallaron en el interior de una casa vacìa de la calle Garcìa Herrero, en la colonia El Cerezal, los cuerpos de Estefania Riva, de quince años, y de Herminia Noriega de trece [1]. » Magnifique espagnol, si simple, si pur qu’un hispaniste très moyen comme moi peut en lire des pages et des pages sans beaucoup de difficultés. Et l’on se demande d’ailleurs du fait de cette limpidité presque racinienne, anti-baroque, pour quelle raison la traduction – qui globalement donne l’impression de fonctionner – est si souvent marquée d’incompréhensibles barbarismes ou contresens, erreurs de lecture…
Si 2666 est devenu très vite un livre mythique ce n’est pas seulement pour des raisons de façade – œuvre ultime, œuvre posthume, œuvre énorme, faux mystères sur les intentions de l’auteur – un seul volume monstrueux ou cinq volumes séparés –, mythe à la Kafka sur la pseudo-trahison des dernières volontés de Bolaño par son éditeur, chef-d’œuvre inachevé… bref ce scénario mythologique – toujours le même – qui prescrit que le livre devient mythique quand il est un chef-d’œuvre qui échappe à son auteur par les manigances de deux protagonistes traditionnels, la mort et la société. Il faut que l’écrivain, par un tragique manque à jouir, ait été privé, par ces deux complices, de pouvoir tirer de son écriture, bénéfices, rentes, droits d’auteur, contrôles sur le bon à tirer, propriété littéraire, jouissances de la notoriété… Le mythe le prive de tout cela pour lui donner en compensation un autre prest