Représenter la face humaine (sur le daguerréotype de M. Huet)
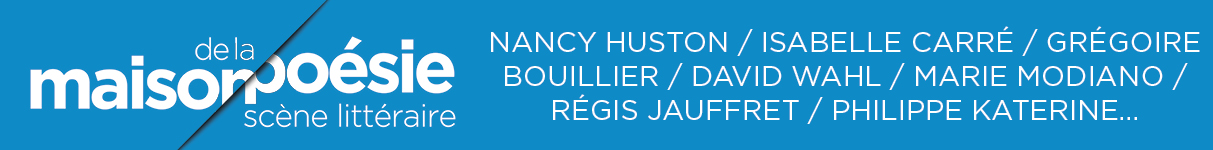
Jean Baptiste (dit Constant) Huet n’est l’auteur d’aucun chef-d’œuvre. Et pourtant, les historiens de la photographie connaissent son visage. La raison en est simple. Ce graveur parisien, né en 1796 dans une famille de peintres naturalistes, a laissé ses traits sur une plaque de métal poli. Un acte photographique que l’on doit au célèbre Louis Daguerre. L’épreuve ? Elle a été réalisée dans le Cabinet d’histoire naturelle, rue du Jardin-du-Roi, au matin d’une journée d’été 1837. Une pièce que le marché de l’art évalue aujourd’hui à plus d’un million d’euros.
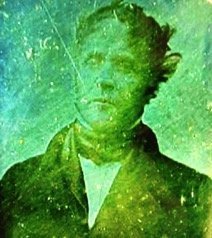
Mais ce n’est pas la côte financière ni l’expertise technique qui singularise un tel cliché. Sa valeur tient avant tout à ce qu’il fait voir. Que montre ce daguerréotype, sinon par opposition ce que furent les conditions du développement du portrait bourgeois, celui de la ressemblance et de la figuration. Un genre qui ne fera, lui-même, que recycler les conventions de la peinture pour représenter la figure humaine. Des conventions qu’André Félibien avait au XVIIe siècle théorisé sur un principe : « la figure humaine est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la terre ». Avec la photographie, le visage semble prendre sa revanche sur le portrait. Les artifices picturaux ? Ils vont progressivement disparaître au profit d’une mise en scène spécifique : celle du face-à-face. En réalité, c’était là une autre illusion. Car ce qui va se développer, sous les apparences d’une réalité sans médiation, c’est ce que j’appelle une interface. Cette image frontière est posée entre deux entités, l’émetteur et le récepteur. Hier simple plaque de métal ou verre, elle est devenue un écran au-delà duquel les apparences seront rationalisées mais cette fois par la communication. Ce dispositif permet de réguler les échanges de regards. Il le fait toutefois avec infiniment plus de puissance que les images publiques du passé. Peintes ou sculptées, celles-
