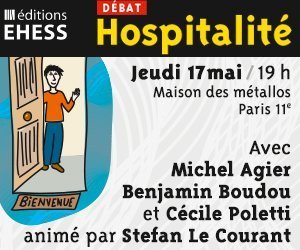Antithèses, figures de thésards
Il est assez plaisant, il faut l’avouer, d’entreprendre d’écrire un texte pour AOC – où la plupart des contributeurs, et sans doute des lecteurs, ont dû envisager un jour ou l’autre d’être « doctorants » – sur un essai consacré aux affres de la thèse, cette institution universitaire hyper-codifiée, parfois traumatisante, dont le statut a beaucoup évolué depuis le 19e siècle. C’est, entre autres, ce qu’étudie Charles Coustille dans son essai malicieusement intitulé Antithèses et qui bien sûr, avant de devenir un livre, fut aussi… une thèse !
On peut lire cet ouvrage vif et bien documenté selon plusieurs modalités : en s’intéressant aux cas qu’examine de façon privilégiée l’auteur (Mallarmé et Céline, annonce la couverture, mais surtout Charles Péguy, Jean Paulhan et Roland Barthes : trois « thésards » problématiques…) ; en s’interrogeant sur l’histoire des pratiques et rituels universitaires qu’il propose par ce biais (depuis le temps lointain des années 1920, où la France ne comptait que 50 000 étudiants pour un petit millier de professeurs) ; en utilisant enfin ses conclusions comme point de départ à une réflexion élargie sur les relations contemporaines – parfois compliquées – entre le monde académique et la création littéraire, mais aussi sur la place de la critique aujourd’hui.
La libre confrontation d’un écrivain à l’arbitraire des normes académiques peut ainsi produire de drôles de résultats…
Qu’est-ce donc qu’écrire une thèse ? Pour quels lecteurs, hormis un « jury » de quelques personnes ? Selon quels principes, esthétiques, scientifiques ? Dans quelle relation exacte avec son propre désir d’œuvre, s’il existe ? Coustille envisage toutes ces questions à travers l’examen monographique de trois « cas » assez passionnants, qui révèlent, chacun à sa manière, une tension entre un certain idéal de la littérature et l’épreuve que lui fait subir un exercice aux contraintes strictes, d’une certaine façon artificielles. La libre confrontation d’un écrivain