Les voir, les entendre – sur quelques livres à propos des migrants
Une des différences entre les migrations antérieures et la situation migratoire actuelle en Europe tient à l’effet-masse qui transforme les arrivants en une foule compacte, sans nom, sans visage. Les migrants, à prononcer lesmigrants, où résonne presque un singulier collectif. Auparavant, ils venaient au moins de quelque part, les Algériens, les Polonais, les Portugais, et au demeurant, on les appelait les immigrants ou les émigrants, marquant soit un point de départ (émigrant), soit un point d’arrivée (immigrant). Ceux d’aujourd’hui, les migrants, ne reçoivent une origine que pour des besoins statistiques ou journalistiques. Et aucune individualité.
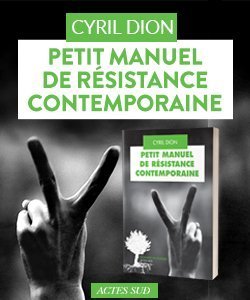
Les accueillir, ce serait déjà apprendre à les voir, à les entendre. Leur fournir cet accueil initial minimal. Exercice difficile, éprouvant car ils viennent de loin, non seulement d’un lointain géographique mais d’une lointain existentiel qui souvent déborde nos limites de connaissance et de sensibilité. Leur là-bas est un au-delà. Sur ce postulat exigeant, Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky publie La Voix de ceux qui crient. Rencontre avec des demandeurs d’asile, un livre indispensable, douloureux, militant.
Dire l’indicible, raconter l’irracontable, le parcours qui mène d’avant à maintenant, d’une existence menacée à une identité amputée. Le trauma est une blessure psychique particulière en ce qu’il échappe aux codes culturels et symboliques qui pourraient l’exprimer. Au contraire, il en proclame l’inanité ou la vacance, ce qui redouble la souffrance du sujet traumatisé. De surcroît, pour un thérapeute face à un tel patient et provenant d’un terreau culturel non familier, la difficulté majeure tient à une impossibilité initiale de recourir à un code culturel commun, une impossibilité de trouver ou suggérer des modes de figuration de substitution qui permettraient au sujet de tenir à distance sa souffrance.
C’est le cas des hommes et des femmes demandeurs d’asile en France, venus d’une quinzaine de pays dont
