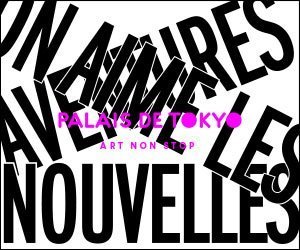Quand les Carters se paient le Louvre
La surprise est grande à la découverte de ce clip éblouissant dans lequel deux stars américaines de la musique populaire – Beyoncé et Jay Z dits les Carters, du nom de famille de Monsieur – déploient leur univers musical et visuel à cheval entre R&B et Rap dans les grandes galeries de peintures du musée du Louvre, et dans quelques autres salles où se trouvent la Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo ou encore le Grand Sphinx de Tanis.
La surprise est d’autant plus grande qu’outre le choc des cultures – d’un côté, le temple des chefs d’œuvre dans leur fabrique européenne ancienne, et de l’autre, la musique africaine-américaine d’aujourd’hui – le premier visionnage du clip ne permet pas de comprendre l’enjeu de cette rencontre inattendue, pourtant tout sauf anodine. La complexité de l’accès au musée du Louvre en dehors des longues queues touristiques et la protection jalouse des droits de reproduction des peintures et des sculptures de l’institution laissent imaginer les démarches nombreuses et le coût exorbitant d’une telle production. À vrai dire, c’est même plutôt inimaginable. Et, à l’opposé, la sophistication de l’image des deux chanteurs invite à penser que le lieu de tournage fut longuement mûri.
L’assaut et l’appropriation de l’univers muséal par la culture populaire – y compris dans Black Panther – en fait le fleuron de la société occidentale, le drapeau dont il faut s’emparer dans le renversement des symboles et qui signe l’aboutissement du processus d’ascension sociale. À moins qu’il ne s’agisse de revanche raciale ? En même temps – ce que d’autres événements muséaux contemporains, à l’instar du débat sur les restitutions du patrimoine africain, tendent à confirmer – le clip fait du musée le dernier bastion, encore tabou, de l’inégalité de la répartition des richesses, hier et aujourd’hui.
Beyoncé et Jay Z se paient le musée du Louvre. They don’t know how they made it (Ils ne savent pas comment ils ont fait) est une phrase récurrente de la cha