Maylis de Kerangal à l’œuvre
Le roman de Maylis de Kerangal, Un monde à portée de main, porte en son titre comme en son thème la promesse d’un art poétique. La main du peintre, en l’occurrence peintre en trompe-l’œil, le métier choisi par son héroïne Paula Karst, fait idéalement écho à celle de l’écrivain, les linéaments de l’un calquant les lignes de l’autre. Il est donc tentant de voir dans la fiction le prétexte idéal à un manifeste esthétique, au moment où son œuvre, ayant atteint l’apogée littéraire et critique avec Réparer les vivants, se trouve à ce point exact et vertigineux où la liberté de création peut être associée à la pleine maîtrise.
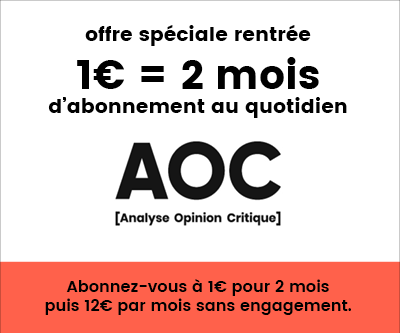
Le livre tient évidemment cette promesse et les parallèles entre l’art de tromper l’œil et celui de mentir vrai ne manquent pas, à commencer par cette faculté, dans les deux cas, de « produire des images » ; mais c’est ailleurs que le roman puise sa force, et se hisse par-dessus ce qu’on attend de lui.
Reconnaître
Le fil conducteur en est le trajet de son personnage principal, suivi depuis sa jeunesse étudiante et sa décision impulsive d’aller apprendre la peinture en trompe-l’œil à l’atelier de la rue du Métal, à Bruxelles. Ici elle fait la connaissance des deux autres personnages, Kate et Jonas. On la suivra dans ses pérégrinations, Moscou, Rome, jusqu’à son ultime chantier, la réplique de Lascaux IV, dans un déroulé d’aventures et de rencontres qui tiennent à la fois du roman d’apprentissage, de la série télévisée et du roman d’amour – où l’auteure, donc, s’amuse avec les références qui lui sont contemporaines et naturelles, avec en point de fuite et en référence Ana Karénine de Tolstoï que son héroïne entreprend de lire. Le lecteur familier des romans de Kerangal retrouvera ses marques les plus personnelles : l’attention à la matérialité du travail, l’inscription des corps et des gestes dans la réalité la plus concrète, le goût des mots qui claquent et des signes faits par le réel, dans ses moindres détails (marques, titres, langues étrangères, noms), le tout pris dans la foulée de son écriture. Les pages d’ouverture annoncent ainsi le propos à venir en même temps qu’elles rappellent dans quel monde, c’est-à-dire dans quelle langue, la lecture va nous plonger : « Paula Karst apparaît dans l’escalier, elle sort ce soir, ça se voit tout de suite, un changement de vitesse perceptible depuis qu’elle a claqué la porte de l’appartement, la respiration plus rapide, la frappe du cœur plus lourde, un long manteau sombre ouvert sur une chemise blanche […]»
Phrases longues, rythme, bascules et surprises, l’entrée en jeu de Paula Karst est aussi une prise en mains de l’auteure Kerangal, que l’on reconnaît ici immédiatement. Le monde à portée de main, c’est tout autant celui que la peinture révèle, celui sur lequel la fiction a prise et la maison, patiemment édifiée pierre à pierre depuis son premier livre, que l’écrivaine a construite avec le ciment de son style.
Regarder
Ici, tout est question de regards. La première phrase nous le signifie d’ailleurs clairement : le personnage apparaît, il est vu, et vite la perspective change, avec l’attention portée à ses paupières sur lesquelles elle étale le fard. On les retrouvera à plusieurs reprises, les paupières de Paula Karst, qu’elle baisse lorsqu’elle revoit Jonas, qu’elle soigne lorsque ses yeux sont brûlés à force d’effort, aggravant son strabisme, on les retrouvera car il est bien normal qu’un peintre apprenne à voir, à dessiller le regard et que le récit des années d’apprentissage et de pratique se condense dans cette partie du corps. « Elle apprend à voir. Ses yeux brûlent. […] Elle les soigne, rince ses paupières à l’eau de bleuet, y dépose des sachets de thé congelé, essaie des gels et des collyres mais rien ne vient apaiser la sensation d’yeux tirés, secs, de pupilles rigides, rien ne vient empêcher la formation de cernes bruns et durables – un marquage au visage, le stigmate du passage et de la métamorphose. »
Mais si le thème du regard est structurel, si, dans ce livre, c’est l’articulation de la vision avec la restitution au plus près (comme un « fac-similé ultime ») qui compte et qui est annoncée, la langue, elle, dit autre chose. Car c’est à l’oreille qu’elle résonne. Plus que visuelle, elle est musicale, construite et développée selon une logique de pure rythmique. Et si l’on tend l’oreille, on entend quelque chose qui est à peine à côté de ce que le livre nous dit, ou semble nous dire.
Ainsi retrouve-t-on une paupière à la fin du roman, et le mot, tout chargé de sa multiple présence à l’intérieur du récit, ne peut être anodin (il ne peut avoir le sens du dictionnaire, ce qui est le signe le plus simple et le plus immédiat du langage poétique). Paula a entraîné Jonas au vallon de Gorge d’Enfer, elle a les clés de la porte. Lorsqu’« elle a ouvert, la lumière du jour est entrée d’un trait – une paupière qui s’entrouvre », qui leur a fait découvrir, sur la voûte, un poisson des temps immémoriaux, « vieux de vingt mille ans ». Poisson dont la présence fait elle-même écho à l’une des premières scènes du livre, lorsque Paula rencontre Kate, qui a des poissons tatoués sur les bras. Comme le poisson de la voûte, qui s’anime quand on le regarde, leurs « nageoires remuent quand elle bande ses muscles ».
Ce système d’échos entre les premières pages et les dernières installe une circularité discrète, mais bien présente. Entre Paula qui s’use les yeux et le rais de lumière lui révélant l’image ultime, l’image ancienne, entre les poissons tatoués et vivants par la grâce de la chair de Kate et le poisson préhistorique, il y a eu un clin d’œil : celui du roman, celui du temps de la lecture. Le temps se replie alors et à la fin du livre, le passé de la petite histoire, à échelle infime, des personnages, est lui-même recouvert par le Temps en personne, incarné, de manière rituelle, dans les images d’avant les hommes. Ainsi passe-t-on de la première apparition de Paula, dans la toute première phrase, à sa disparition, fondue dans l’image « préhistorique et pariétale » : dans le temps.
Retrouver
Ce mouvement est évidemment paradoxal. La matière, travaillée et retravaillée, par laquelle les gestes d’un personnage, ses mains petites et carrées, le mouvement de ses cheveux, son pas sur l’asphalte, l’appartement de ses parents, les cigarettes fumées et les coups bus, les mains dans les cheveux de l’amant, tout cela, à force d’être inscrit dans le courant ou les rainures de la langue, génère un plein de présence qui finit par s’évaporer dans une image projetée (dans une image d’image) : ce n’est que de la fiction, ce n’est que du mensonge, et l’analogie avec la peinture trompeuse, celle qui est si bien réalisée dans sa fausseté qu’elle est plus vraie que vraie, clôt le livre de la même manière que le titre l’avait ouvert. Paula est une image qui crée des images, elle-même créée par une auteure qui crée, etc.
Il est alors aisé de voir dans le portrait de Paula Karst tracé par Maylis de Kerangal un portrait de l’artiste par elle-même. Débusquer l’écrivaine derrière le personnage qui serait son calque, dont le contour collerait sans pour autant qu’on l’emplisse des mêmes choses, exactement, est l’un des réflexes de lecture que provoque tout naturellement non seulement la thématique poétique ouvertement assumée du livre, mais également son plein de réel. Paula Karst est notre contemporaine, elle est ancrée dans l’environnement social et culturel d’une génération très proche de celle de l’auteur, qui fut enfant dans les mêmes années, jeune adulte dans les années 2000 et récemment percutée par les attentats de 2015. Les vêtements, les marques de cigarettes, les chansons, les modes, tout ce qui fait le charme de cette jeunesse qui va (ou qui est allée) tient dans le fait qu’il nous évoque d’une proximité générationnelle – d’une proximité dans le temps.
C’est précisément dans cette proximité que le livre dépasse les attendus qu’on pourrait lui assigner (délivrer une théorie de l’écriture, du roman aujourd’hui, offrir une réflexion sur son art) ; de même que son héroïne, il part, court, file, de rencontre en rencontre, à travers les rues, les nuits, les bars et les pays. Il est agité comme l’est la jeunesse, non comme on imagine qu’elle l’est, mais comme elle doit l’être parce qu’elle est vitale, et cette pulsation excède le cadre de son entreprise demi-documentaire. Si, à la fin, l’évaporation de Paula Karst dans l’image est plus qu’une évocation somme toute assez commune sur la puissance d’incarnation de l’art, c’est que, dans le temps de la lecture, le lecteur a été embarqué avec elle dans sa jeunesse retracée. Et qu’il a retrouvé, avec elle, sa puissance de débordement : la vitesse, le goût de la nuit, l’image de soi, les rencontres, les souvenirs des parents et de l’enfance peu à peu lointaine, la découverte de l’amour, les amis, et la solitude parmi les autres (« peindre au milieu d’un collectif la déstabilise et l’oppresse »). Dès lors, l’analogie Kerangal-Karst vaut non pour une théorie de l’écriture, ou pour un art poétique, mais pour ce qu’elle révèle de discrètement mélancolique, dans une sorte d’adieu de l’auteure à son passé au moment même où elle le recrée. Affirmation de sa puissance littéraire, et principe de liberté total où l’écrivaine, souveraine, signifie qu’elle a définitivement pris la main sur le temps. Et qu’en plus d’écrire des livres, elle construit une œuvre.
Maylis de Kerangal, Un monde à portée de main, Verticales, 288 pages.
