Entre écrans et pierres, un roman de Fanny Taillandier
Assez vite, c’est-à-dire dès le début, on se dit que le troisième roman de Fanny Taillandier n’est pas un texte sur le 11 septembre, ni même peut-être sur l’impossible image, l’impossible imagination des catastrophes, mais sur la puissance létale du média. Pas besoin d’être grand clerc, c’est dans le titre : Windows on the World, le nom du restaurant situé au sommet de la tour nord du World Trade Center, littéralement « Fenêtres sur le monde », y est transformé en « écrans » : Par les écrans du monde. On n’observe plus, on ne passe plus au travers : au contraire, le regard s’arrête, se projette et cherche ce qu’il a bien pu mettre dans l’image qu’il a devant lui. Nos représentations du monde sont définitivement devenues modernes. Exit la fenêtre, voici l’écran et la désillusion. Illudere : leurrer mais aussi littéralement « emmener jouer ». Il n’y a plus de jeu, tout est désormais très serré, étroit. Les murs de la prison se rapprochent.
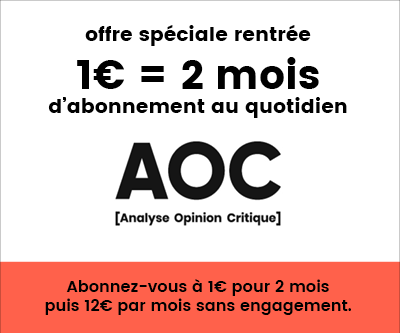
Par les écrans du monde n’est pas le premier roman français sur le 11 septembre (on se rappelle Windows on the World de Frédéric Beigbeder chez Grasset en 2003, on sait que nombre de textes d’Hélène Cixous chez Galilée, depuis Tours promises en 2004, y font référence) mais ce qui le distingue peut-être historiquement, c’est qu’il est le premier à être écrit après Charlie, après le Bataclan, dans une ère où nous sommes presque devenus habitués à recevoir de futurs messages d’outre-tombe, des appels, des images, des messages de gens qui nous informent qu’ils vont mourir, c’est-à-dire que nous allons mourir – maintenant.
C’est la première page du roman : un père téléphone à ses enfants, à six heures du matin, le 11 septembre 2001. La scène est « hors-champ » écrit Taillandier. L’auteure décrit une pelouse, un lac pour lesquels « faute de film, nous n’aurons pas un regard ». Elle écrit : « le paysage a l’air d’une photo peinte ». L’homme joint d’abord sa fille Lucy, puis « dans la demi-heure qui suit » son fils William : « Je t’a
