Glenn Ligon : du noir, du blanc et des néons pour penser le racisme
On dit souvent que les œuvres d’art s’expriment d’elles-mêmes, que l’on peut y projeter de nombreux imaginaires et que des explications ne sont pas toujours nécessaires. Néanmoins, écouter l’artiste parler de son travail engage à une compréhension que l’on pourrait appeler « élargie » du processus privilégié, de la recherche menée et du résultat escompté. La clarté des propos de Glenn Ligon lors de la conversation qui était proposée par la Galerie Chantal Crousel à Paris où il expose pour la première fois, permettait d’appréhender des productions inédites à la lumière de ses références historiques, littéraires et artistiques.
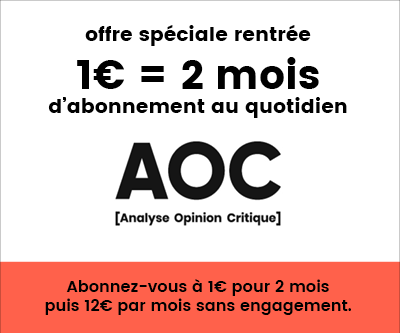
L’artiste américain (né en 1960 dans le Bronx à New York) revenait notamment sur l’une de ses peintures iconiques Untitled (I Am a Man) réalisée en 1988. Cette huile et émail sur toile (d’un format de 101.6 par 63.5 centimètres) est la première qu’il réalise en s’appropriant un texte existant, ici celui de la pancarte portée par les agents de nettoyage en grève dans la ville de Memphis en 1968. Sur un fond blanc, les lettres se détachent en noir et en capitales I AM A MAN. Le verbe souligné accentue le statut revendiqué dans un contexte où ces travailleurs africains-américains exploités et moins payés que leurs collègues blancs affirment leur nature humaine. Dans la continuité de l’ouvrage publié par Ralph Ellison, Invisible Man (1952), ils confirment leur visible dignité. On apprend par Glenn Ligon qu’à l’origine, cette toile était un monochrome noir qu’il a choisi de recouvrir de blanc et de ces mots. De façon générale, cette notion de strates est importante dans son travail, les couches sont autant celles d’une matérialité picturale que celles d’une généalogie à déployer pour penser les discriminations aux États-Unis.
C’est à l’hiver 1968 que la grève commence à Memphis dans l’état du Tennessee ; des années de salaires de misère et de conditions de travail dangereuses font éclater la contestation onze jours après la mort, le 1er février,
