Alain Badiou, la révolution et le communisme
Le récent livre d’Alain Badiou Petrograd, Shanghai. Les deux révolutions du XXe siècle (La Fabrique) surprend par son titre. Les deux villes sont mises en avant comme si elles permettaient de comprendre deux des transformations majeures du XXe siècle. L’ouvrage, bref et dense, est formé de quatre chapitres. Deux proposent une interprétation des deux révolutions : pour l’URSS il s’agit de la période de 1917 à 1929, centrée sur octobre 17, et pour la Chine de la Révolution culturelle prolétarienne. Deux autres chapitres loin de décrire le processus révolutionnaire dans les deux villes présentent sous une forme thématique deux textes de quelques pages qui ont joué un rôle majeur, mais comme beaucoup d’autres, dans les deux révolutions. L’un, les Thèses d’Avril, où Lénine tout juste arrivé dans la capitale de la Russie après un long exil, formule un projet de transition vers le socialisme ; l’autre est la Décision en seize points du Parti communiste chinois d’août 1966 donnant des directives pour la Révolution culturelle, décision en partie rédigée par Mao Tsé-Toung, que Badiou associe à la Commune de Shanghai qui dura vingt jours en février 1967 [1].
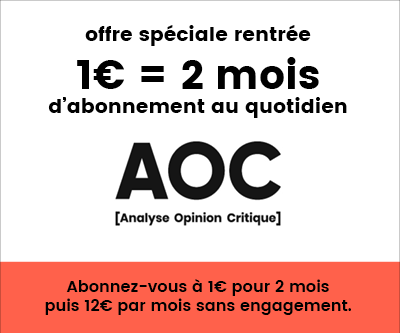
Ces moments révolutionnaires du XXe siècle sont vigoureusement valorisés par référence à une révolution du XIXe siècle, la Commune de Paris qu’ils auraient « ressuscitée » : Lénine ne veut-il pas, en avril 17, impulser un « État-Commune » tandis que les Gardes Rouges de Shanghai font de la Commune de Paris leur idéal ? Ainsi la révolution « communiste » apparaîtrait et mourrait en 1871 puis retrouverait la vie en 1917 et en 1967, comme un principe défiant la mort tel, disons, le Christ. Les deux révolutions ont échoué conduisant au rétablissement du capitalisme mais chacune a connu un moment où était présent l’esprit de la Commune dont l’intellectuel maoïste espère qu’il reviendra.
Les brefs moments communistes de l’histoire sont pris dans une durée immense que Badiou replace dans la destiné de l’humanité. Celle-ci a une
