L’ère de la fiction sociologique ? – à propos des nouveaux romans de Bégaudeau et Filippetti
La sociologie, science des régularités, a depuis longtemps mis au jour la loi d’airain de l’homologie sociale, qui est la condition de la reproduction de la société. Qui se ressemble s’assemble : l’adage s’appuie désormais sur une assise statistique incontestable et franchement désespérante. L’homogamie en reste le premier indicateur : en 2011, seuls 2,8% des ouvriers vivaient avec une femme cadre supérieur, alors que 4% des bac + 5 cohabitaient avec une femme sans diplôme. Le choix du conjoint est un choix fort contraint, en dépit de la généralisation du mariage dit d’amour. On aime d’abord dans sa classe, car on aime d’abord sa classe dans l’hexis corporelle du partenaire.
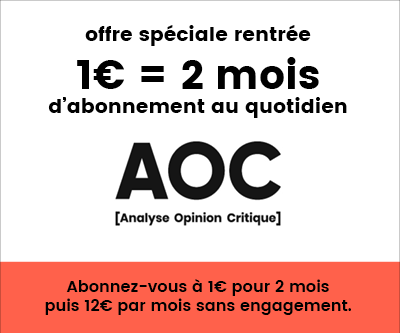
L’art et la littérature ne sont pas soumis aux mêmes contraintes : on peut y expérimenter des rencontres improbables, le schème le plus connu étant celui du prince et de la bergère, dont la passion vient brouiller les règles cruelles de l’immobilité sociale. Si, à l’âge classique, Don Juan est aussi scandaleux, ce n’est pas parce qu’il séduit des jeunes femmes qui ne sont pas de son milieu (tous les aristocrates font ça tout le temps), mais parce qu’il les place sur un pied d’égalité sociale qui contrevient à la règle de base d’une société d’ordres bien plus qu’à la morale sexuelle. Les amours ancillaires sont légion dans la réalité et l’on en fait rarement une affaire. La fiction apparaît ici comme une expérimentation sur les barrières sociales, laquelle s’appuie sur la magie de rencontres improbables. Le plaisir renouvelé de ce qui pourrait ressembler à un poncif doit être expliqué par l’excitation qui naît de la subversion, même temporaire, des routines sociales. Il y a une autre dimension dans ce jeu : celui de la transgression des normes imposées et de la production d’un univers secret que les homologues de l’un et l’autre partenaires ne seront jamais à même de percevoir.
Deux romans récents, œuvre d’écrivains aux trajectoires à peu près parallèles, permettent de revenir sur les potentiali
