Série noire de Bertrand Schefer : entre fiction et réalité
Il existe des auteurs qui sont tout à la fois de fins théoriciens et d’excellents romanciers, capables de vous entraîner dans les aventures de leurs héros et vous tenir réveillé dans de rocambolesques histoires tout en vous donnant à réfléchir sur des questions purement formelles. Ainsi Bertrand Schefer, qui a pensé son dernier livre comme un exercice périlleux de mise en abyme démultipliée, sorte de réflexion à plusieurs étages autour de l’influence de la réalité sur la fiction et de la fiction sur la réalité. En dehors de toute considération sur le passionnant intérêt théorique d’une telle entreprise, et du nombre de questions qu’elle pose, il faut reconnaitre avant tout que Série noire se dévore comme un polar.
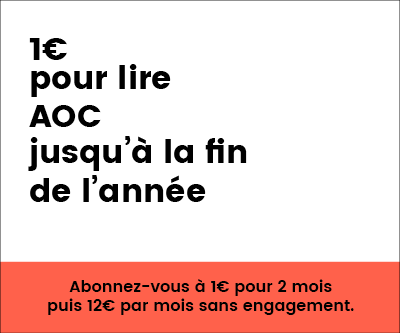
Série noire, donc, du nom de la célèbre collection. Elle est au centre du livre, comme le catalyseur de ce qui, commencé comme une histoire emblématique de ce qu’on pourrait appeler le rêve occidental des trente glorieuses, se transforme en spectaculaire fait divers.
En 1960, des escrocs organisent l’enlèvement du fils de la richissime famille Peugeot, propriétaire des voitures du même nom, et réclament une rançon. C’est le premier rapt de ce genre en France.
Les écrivains partant d’un fait réel pour construire un roman sont nombreux aujourd’hui. À la vague autobiographique et autofictionnelle se sont ajoutées, pour le meilleur – mais parfois pour le pire – ce qu’on appelle depuis peu les exofictions. C’est même une des spécificités françaises parmi les littératures européennes que de triturer inlassablement les notions de fiction et de réalité. Pourtant ce Série noire est particulier, puisque l’auteur questionne le sujet à l’intérieur de la réalité elle-même. Dans le fait divers reconstitué par Bertrand Schefer, les malfrats pour commettre leur forfait et le mener à bien s’étaient directement inspirés d’un livre, Rapt, premier roman de l’Américain Lionel White, publié en France dans la collection Série noire de Gallimard. Jusqu’à recopier mot pour mot la
