Retour hélas manqué à Reims – quand Ostermeier dilue Eribon dans l’actu
Il y a dix ans paraissait en France le récit intime d’une personnalité très largement reconnue du monde intellectuel, Didier Eribon. Sociologue, biographe de Michel Foucault, penseur pivot de la question gay, Eribon n’était pas le premier à s’essayer à la confession au sens littéraire. Les intellectuels qui inventent des concepts dont ils usent avec force pour déchiffrer la vie autour d’eux et en eux sont nombreux à revenir sur leur moi le plus enfoui. Tous n’y parviennent pas. L’autobiographie n’est pas l’analyse de l’ordre du monde, il vaut mieux commencer par séparer les deux genres pour apprécier à leur juste valeur les écrivains qui arrivent justement à les fondre. Dès 2009, année de la publication originale de Retour à Reims, il fut clair que le sociologue avait réussi la fusion.
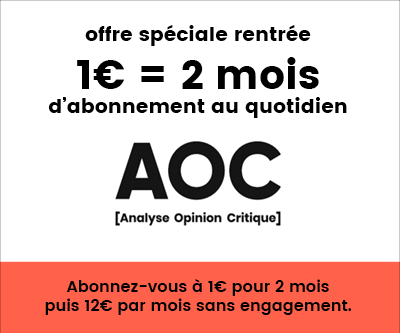
La presse, les écrans, les réseaux sociaux, les selfies : tout porte à croire qu’un claquement de doigt, plus ou moins complaisant ou plus ou moins impertinent, suffit à faire de soi une matière à penser. C’est une illusion. Il faut, pour y parvenir, un recul sur soi pour mieux s’y plonger, et même plus, paradoxalement, une forme d’oubli de soi pour arriver à se projeter, s’imaginer dans le regard de l’autre, puis déchiffrer et décrypter ce regard avec des outils qui sont autant de moyen de servir d’accroches. Il faut aussi des qualités d’écriture, et il ne s’agit pas de simples règles d’un français bienséant, d’autant moins chez un homme qui est en grande partie autodidacte. Enfin, il faut ce qu’il y a de plus difficile à définir, la sensibilité, celle de l’auteur, mais aussi celle du lecteur et la rencontre des deux. Tous ces éléments sont réunis dans Retour à Reims, un livre qui entrecroise deux sentiments longtemps cachés, honte sociale d’appartenir au milieu ouvrier et honte sexuelle d’être un homme homosexuel.
L’homme de théâtre et l’homme du livre partagent autre chose : ils sont tous deux animés par leur perplexité et leur inquiétude face à une Europe qui dérape, privée d’un
