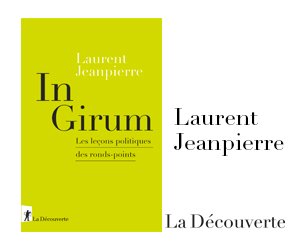Aux fils du temps – à propos d’Amazonia de Patrick Deville
Parcourir la jungle, la terrible jungle, laisser s’infecter les plaies, s’épuiser jusqu’à en devenir fou, tout cela est-il bien raisonnable ? En remontant le fleuve Amazone avec son fils en 2018, périple que raconte Amazonia, Patrick Deville ne traverse personnellement aucun de ces calvaires, mais il collecte quantité d’histoires sur des aventuriers morts ou détraqués par des rêves et de grandes espérances.
En réponse à la question « à quoi bon risquer ainsi sa vie ? », lui revient en mémoire un personnage imaginé par le Brésilien Antônio Callado, dans son roman A expediçao Montaigne (non traduit en France). L’Indien Ipavu quitte sa tribu et arrive dans la ville des Blancs : « C’était con d’habiter dans la forêt, de boire du cachiri aigre dans une calebasse, alors qu’il pouvait s’en mettre plein la lampe de bière et se tailler au moment de payer l’addition. »
On dort mieux dans un lit que dans un hamac, mais Patrick Deville sait que les voyages sont nécessaires pour se nourrir de ces « épices morales, dont notre société éprouve un besoin plus aigu en se sentant sombrer dans l’ennui. » C’est une phrase de Lévi-Strauss, auquel Deville emprunte aussi l’exergue d’Amazonia, le célèbre incipit de Tristes Tropiques : « Je hais les voyages et les explorateurs. » Mais c’est faux, Deville aime les voyages lointains. L’écrivain, qui se peint lui-même en homme rugueux, n’est pas sans coquetterie, de même qu’il est à la fois profondément libre et amateur de rituels qui confinent à l’obsession. Trois jours par an, à dates fixes, le 21 février, le 31 décembre et le 15 août, il réfléchit seul, allongé dans une pièce obscure, aux conversations passées et aux travaux à venir. Deville part souvent mais il sait se poser. Même lorsqu’elle distribue quantité d’informations, son écriture dégage une indolence élégante.
Ainsi fonctionne Deville : il digresse vite et de façon tellement serrée que lecteur le suit dans sa course et accumule le savoir sans rien en lâcher.
Amazonia es