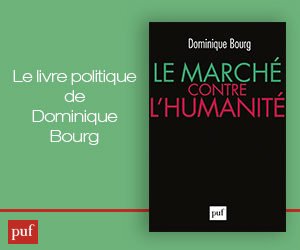Martin en notre jardin d’Eden – à propos d’ Un autre Eden de Bernard Chambaz
Si les enfants ont une telle peur des fantômes c’est qu’ils ne les reconnaissent pas, ils sont bien trop jeunes : ne les ayant pas connus vivants, ils ignorent lesquels sont haïssables, lesquels désirables, lorsqu’ils s’y cognent à chaque coin de nos phrases, de nos mots, quand d’une mimique ou d’une tournure d’esprit nous les laissons revenir dessous la conversation – et subitement flotte une présence, derrière le rideau, sous la table ; l’enfant ne saurait dire où précisément mais qu’on ne lui demande plus d’aller se coucher seul. Les fantômes sont partout, dans nos langues qu’ils ont façonnées, et combien de vivants réputés tels qui le sont déjà un peu, fantômes d’eux-mêmes ? La frontière est si poreuse. Moi-même, certains jours, j’avoue être pris de doutes. Ne suis-je pas l’un seulement de cette foule de fantômes que j’ai rêvé devenir ?
Ce qui est sûr, c’est que la bibliothèque leur est un jardin d’Eden, à ces fantômes qui, d’être morts, ont cessé de vivre, mais pas d’exister. À qui en douterait on ne saurait trop recommander de lire Un autre Eden, de Bernard Chambaz – et j’ai failli écrire « de Martin Eden » tant le double individualiste de Jack London me tire la manche, à ma table de travail, si fier et ravivé qu’il est d’habiter de nouveau un livre des grands espaces où tout fut possible, et pourquoi ce qui fut possible ne le serait-il plus ?
Il suffit d’ouvrir le livre comme on entre au jardin, les fantômes y foisonnent qui surgissent à l’instant propice pour mettre leur grain de sel dans l’histoire de Jack London, l’homme qui avait renoncé à chercher de l’or pour en produire sur la page : je veux dire, pour inventer une œuvre populaire d’une telle puissance vitale que s’y enracine une part florissante de la littérature américaine. On croise ici quelques-uns de ses plus illustres représentants, de Henry Miller à Jack Kerouac, ils rient souvent, ils parlent beaucoup. Quant au rôle de Virgile, il revient pour une part et comme il se devait à Herman