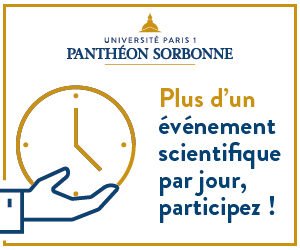Ceux qui demeurent – sur Le bel été de Pierre Creton et quelques autres films migratoires
Il est assez aisé de constater combien, au cours des dernières années, la question des migrations est devenue l’un des terrains décisifs du débat social et des décisions politiques, notamment en Europe. Le cinéma peut apparaître comme un observatoire particulièrement intéressant de l’importance contemporaine de ce phénomène et des sujets qui en sont protagonistes – à partir du constat de la place de plus en plus significative qu’ils ont gagnée dans la création filmique.
Tout d’abord, dans le cinéma documentaire. À ce propos, Les Cahiers du Cinéma renommaient significativement « terre d’accueil » le FID de Marseille – l’un de plus importants festivals francophones consacrés au créneau documentaire et expérimental. À ces thèmes, entre autres, était consacré le film lauréat de la compétition française La mer du milieu de Jean-Marc Chapoulie, avec la complicité de la plume de Nathalie Quintane.
En réalité, en observant leurs politiques de programmation où la migration dans toutes ses occurrences très rarement s’absente, la plupart des éditions récentes des festivals documentaires (du Réel parisien jusqu’aux États Généraux à Lussas) aurait pu faire l’objet de remarques similaires. Même au festival de Cannes, cette année, une attention particulière a été portée à ces questions à travers la fiction Atlantique de la jeune réalisatrice Mati Diop, qui a remporté le prestigieux « Grand Prix ».
En décalage par rapport à la plupart des films racontant les difficiles déplacements et le thème de la frontière (surtout dans la production documentaire : de Brûle la mer de Nathalie Nambot à Des spectres hantent l’Europe de Maria Kourkouta et Niki Giannari, jusqu’à Fuocommare de Gianfranco Rosi), un des défis les plus intéressants du premier long-métrage de Mati Diop était de composer un récit depuis ceux – mieux, celles – qui restent. Plutôt que depuis ceux qui partent.
Dans un contre-champ où l’Afrique n’est plus l’ombre d’un souvenir abandonné derrière soi, mais un territoire actuel : de départs, d’existences et de retours (fantomatiques). Une option que la réalisatrice avait déjà en partie travaillé avec son beau court-métrage Atlantiques (au statut documentaire) dans le cadre de sa formation à l’école du Fresnoy, il y a dix ans. Le mérite du film présenté à Cannes nous semble résider d’abord dans un renversement de perspective et de géographie, ainsi que dans la recherche intuitive d’une ligne ambiguë entre le réalisme et le fantastique spectral, qui convoque la culture populaire des Djinns. À cela ajoutons quelques intuitions plastiques saisissantes, comme la jungle urbaine de Dakar – filmé de loin et de près – qui parfois rappelle des imaginaires à la Blade Runner. Il est dommage que les diverses pièces du film n’atteignent parfois une cohérence fluide et crédible. La trame (qui entretisse plusieurs motifs de genre : du noir au feuilleton sentimental) n’arrive pas à convaincre jusqu’au bout.
Au FID 2019, en juillet, était également présenté en avant-première le dernier film du réalisateur normand Pierre Creton, véritable habitué du festival phocéen, qui accompagne sa carrière cinématographique depuis de nombreuses années. Dans son mode de vie très sédentaire (devenu une véritable économie de création et une signature artistique), le voyage marseillais constitue un des rares déplacements de sa Normandie rurale que ce réalisateur entreprend régulièrement.
Aux récits ensoleillés des traversées désespérées et des frontières surveillées du bassin méditerranéen, son Bel été amenait le souffle frais d’une histoire d’hospitalité qui longe les falaises vertes de la mer septentrionale. Une autre mer, un autre été, d’autres alliances – comme dans Pourquoi la mer rit-elle ? d’Aude Fourel, film présenté lui-aussi au FID 2019, où une traversée est tracée, mais à l’envers (de l’Europe au Maghreb), le long d’une enquête autour d’un maquis sonore de la résistance algérienne dont la mémoire s’est estompée.
Ce n’est pas une histoire de fantômes ni de voyages périlleux ; c’est une histoire de ceux qui restent.
Parmi les sillons des disparitions et des pertes des confins méridionaux, le film de Creton nous invitait à une demeure estivale de vie et de rencontre : la sienne, où il s’était retrouvé à accueillir des jeunes migrants. Le récit du Bel été se dessine loin de la Méditerranée tragique où l’hystérie de l’ex-ministre italien Salvini était en train de fermer les ports avec la complicité de l’UE – sans pouvoir l’oublier pourtant.
Dans le dossier de presse qui annonce la sortie en salle imminente du film, Creton expliquait : « S’il y a des fantômes, ce sont les noyés de la Méditerranée ; les garçons arrivés jusqu’ici sont eux, bien vivants. ». Celle-ci n’est donc pas une histoire de fantômes. Ni de voyages périlleux. C’est une histoire de ceux qui restent. C’est une histoire de ceux qui sont arrivés, accueillis par ceux qui ont demeuré.
Le choix de demeurer dans son pays natal – rural, paysan et plutôt éloigné des principaux circuits culturels – représente un geste crucial de la biographie personnelle et artistique de Pierre Creton. Ses écritures cinématographiques ne peuvent pas se comprendre en dehors de la décision de cet auteur de s’installer dans son Pays de Caux à l’issue d’une formation en École d’Art – à l’encontre de l’exode parisien (ou, en tout cas, urbain) de ses camarades. Le cinéma de Creton surgit du territoire et du quotidien d’une vie déployée au cœur de la campagne normande où le cinéaste a longtemps travaillé comme ouvrier agricole.
De cette proximité en tant qu’habitant et travailleur avec le monde paysan et son paysage ordinaire se développent ses films comme autant de dispositifs d’enquête et de narration lyrique d’un espace à la croisée entre le social et l’intime. D’ailleurs, tous les éléments du petit univers de Pierre Creton sont discrètement catalogués dans un court métrage tourné par David Yon et Robert Bonamy En attendant le Bel Été, disponible en ligne : le public qui ne connaît pas encore le cinéma du cinéaste normand pourrait en profiter pour atterrir en douceur au Pays de Caux.
L’attachement de Creton au paysage normand aura sans doute permis à cet auteur de se rapprocher des œuvres de Cesare Pavese, un auteur italien qu’il aime particulièrement, dont l’écriture et la biographie ne peuvent pas faire abstraction d’un rapport profond aux territoires ruraux des Langhe. Le dernier travail de Creton porte la marque de cette affinité intellectuelle dans son titre même qui reprend celui d’un célèbre roman de Pavese, La bella estate.
Cependant, la trajectoire du film normand semble – pour certains aspects – retourner la position politique de paralysie mélancolique évoquée par l’espace rural pavesien et son mythe de jeunesse : celui-ci n’a jamais constitué un objet serein, pour Pavese, mais plutôt chargé de questionnements et de troubles. À l’isolement du paysage paysan contemplé par l’auteur italien, se substitue – comme souvent chez Creton – une trame vécue de liens à tisser et raconter. Leur statut est varié et incertain : de l’amitié à l’érotisme en passant par la parentalité.
Certes, des inquiétudes font aussi surface dans Le bel été et Creton est conscient de l’ambivalence de son film comparé à un ex-voto qui, d’une part, célèbre une joie et, de l’autre, en demande : « Un ex-voto est soit une demande de grâce, soit un remerciement : Le Bel été est en effet les deux à la fois. ». Mais le cheminement de son long-métrage dessine surtout le profil d’une rencontre vivante et joyeuse : une recherche commune d’habitation et de famille. Il s’agit d’une famille très hétéroclite et poreuse, peu traditionnelle – une famille d’adoption(s). Comme celles défendues par Donna Haraway , pour s’entendre : « make kins, not kids ».
La maison de Creton ne nous renvoie aucunement à un horizon identitaire et fermé, mais plutôt à des espaces de mélange (sensuel, lyrique, fabuleux).
La question de savoir rester et d’habiter nos milieux de vie dans le monde de la mobilité permanente autant choisie, qu’imposée – du travail au tourisme en passant par les migrations – représente un art précieux que Creton cultive. Un tel art de la demeure dispose les conditions préalables pour un autre art vital pour notre temps : celui de l’hospitalité. Ce geste ancestral nous renvoie aujourd’hui inexorablement à l’accueil des personnes en migration. Habiter et accueillir dans une campagne repoussée au bord de nos systèmes de valeurs et d’attention représente un défi dont le mouvement (majoritairement rural) des gilets jaunes a été récemment un rappel très puissant.
Bien que conscient des mouvements migratoires confrontés à de redoutables politiques de répression, le film de Creton dépasse ce stade de la réflexion pour nos montrer (au cinéma) ce qui est possible au-delà des régimes de « refugisation » et d’expulsion qui dominent les stratégies de gestion des flux migratoires et nos imaginaires médiatiques. Le camp en est le triste emblème. Le travail de Creton n’oublie pas de faire référence à l’histoire d’un camp bien connu par son alliance avec les cinéastes voisins Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz dont il a suivi le travail à Calais pour L’héroïque lande (2017).
Le bel été suit et prolonge presque l’œuvre de Perceval et Klotz, comme une réponse dans une correspondance. Une réponse spéculaire, qui nous transmet une image retournée : si dans L’héroïque lande le camp de Calais se transformait en une ville chaleureuse où les cinéastes étaient accueillis par une communauté d’habitants en migration, dans Le bel été ce sont plutôt des jeunes migrants qui seront accueillis par des cinéastes-habitants.
« Mes films sont des maisons » a affirmé Pierre Creton. Des maisons prêtes à accueillir qui a perdu sa demeure, des maisons à l’opposé extrême des camps, des maisons où on invente – le temps de quelques mois estivaux – des rencontres conviviales et familières. La maison de Creton ne nous renvoie aucunement à un horizon identitaire et fermé. Mais plutôt à des espaces de mélange (sensuel, lyrique, fabuleux). Comme nous le démontrait son œuvre précédente – le très beau Va toto ! (2017), construit autour de l’histoire d’un marcassin accueilli par une voisine âgée –, ces mélanges domestiques au Pays de Caux peuvent même réunir des espèces vivantes différentes, en composant des compagnies surprenantes.
« Épouse et n’épouse pas ta maison » a écrit René Char dans un de ses aphorismes poétiques foudroyants. Cela pourrait être un bon exergue littéraire au film de Creton qui sort en salle le 13 novembre et, peut-être, plus en général aux films de migration qui se fabriquent aujourd’hui – en France et ailleurs.
Le Bel été, de Pierre Creton, est sorti le 13 novembre.