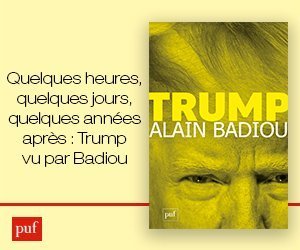Physique des corps et lutte ouvrière – à propos de Querelle de Kevin Lambert
Une fois n’est pas coutume, commençons par des préventions. Le titre : Querelle. La référence au Querelle de Brest de Jean Genet était si aveuglante que nous faisions la moue car nous tenons celui-ci pour un des plus grands prosateurs du XXe siècle. La rumeur : pour qui a l’esprit de contradiction et un peu de métier, quand elle est unanime, le réflexe est de soulever un sourcil dubitatif. Les tenailles conceptuelles utilisées par les uns et les autres pour approcher le roman : elles ont été tant entendues et rebattues que nous étions découragée.
Et pourtant. La curiosité fut plus forte que tout et nous nous sommes plongée dans le premier roman publié en France de Kevin Lambert, un très jeune écrivain canadien francophone. C’est un fait : le livre frappe, tranche et ose. Il conjugue plusieurs traits qui en font un objet venu d’ailleurs, plusieurs éléments qui, en général, s’accordent mal : une littérature ouvrière qu’il perpétue tout en la bousculant ; une théâtralité criante ; une prose, ou plus exactement une voix qui produit un son nouveau.
Querelle est d’abord un roman, un vrai, fondé sur une intrigue et un dénouement : c’est l’histoire d’une grève d’ouvriers d’une scierie de Roberval, une ville québécoise située au sud du lac Saint-Jean, grève dont les meneurs et les casseurs sont les personnages principaux. Le titre du livre distingue d’emblée le personnage homosexuel nommé Querelle. Voyez les premières lignes du roman : elles sont crues, bandées au cordeau, et pénètrent au cœur de la vie sexuelle de ce corps tendu et innocent (au sens de Tony Duvert), qui finira sacrifié.
Ce début est pourtant un trompe-l’œil. Le livre n’est pas le journal d’un innocent. Le roman est sous-titré « Fiction syndicale » et le récit du combat des ouvriers de la scierie est quantitativement bien plus important que celui des ébats de Querelle. Il n’empêche, placer cette chronique ouvriériste sous le signe d’une sexualité qui fait fi de la norme est une provocation flagra