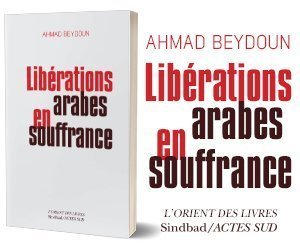De sang neuf rue saints morts – à propos de 209 rue Saint-Maur de Ruth Zylberman
Que penser d’Yvonne Massacré ? Sous l’Occupation, cette femme au nom tragi-comique fut la gardienne de l’immeuble situé 209 rue Saint-Maur, dans le Xe arrondissement de Paris. Est-ce par bonté et vaillance qu’elle avertissait les juifs en agitant son balai, depuis la cour, de l’approche de la police, ou bien était-ce pour elle « une question de rapport », c’est-à-dire un service rendu contre de l’argent ?
Les anciens résidents du « 209 » ont des avis partagés sur la question. Tous ne racontent pas la même histoire à la cinéaste et écrivaine Ruth Zylberman, née en 1971. Pendant plusieurs années, elle a enquêté pour connaître l’immeuble, ses locataires et ses rares propriétaires depuis l’érection du bâtiment en 1850 jusqu’à aujourd’hui. Le résultat est un entrelacs d’histoires, construites de découvertes dues au hasard, de contradictions, de répétitions, de trous de mémoire comblés ici et là, si bien que petit à petit, au fil de la lecture et de la collecte d’informations, 209 rue Saint-Maur. Autobiographie d’un immeuble devient un roman.
Il se densifie à la manière d’une barbe à papa en tournant sur lui-même, puisque Ruth Zylberman revient sur ses pas et dans l’immeuble, retrouve la trace de ceux dont elle a lu le nom sur une liste établie lors d’un recensement, complète, grâce à une rencontre inespérée, un portrait à peine esquissé par un premier interlocuteur. Ruth Zylberman a d’abord filmé cet immeuble. Le résultat fut un documentaire remarquable diffusé sur Arte en 2018.
Cet immeuble, la parisienne Ruth Zylberman l’a choisi par hasard, en flânant, mais un peu aussi pour les drames dont il fut le théâtre.
Contrairement au livre qui essaie de retrouver tous les résidents, le documentaire se concentrait sur les enfants juifs déportés de l’immeuble. Il y en eut neuf ; d’autres furent cachés et survécurent. C’est une carte des enfants déportés de Paris entre 1942 et 1944, établie par Serge Klarsfeld et le géographe Jean-Luc Pinol, qui a révélé à Ruth Zylber