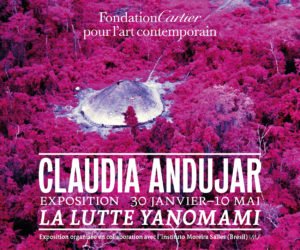Une histoire de l’art inversée – sur Sergueï Eisenstein, L’Œil extatique au Centre Pompidou-Metz
Le cinéma d’Eisenstein a produit des clichés en noir et blanc qui figurent parmi les plus puissants et les plus retentissants de notre imaginaire collectif, à nous, êtres du XXe et du XXIe siècle. Ces clichés étaient à l’origine des photogrammes et des extraits de films. Aujourd’hui et depuis longtemps, ce sont bien plus, des paraboles visuelles, des symboles qui cristallisent et fixent en quelques secondes un des plus grands bouleversements de l’histoire du XXe et sa portée universelle : le landau qui dévale l’escalier dans Le Cuirassé Potemkine, la statue du tsar déboulonnée dans Octobre…
D’où viennent ces images si fortes, si « vivantes et agissantes[1] » ? Dans quelle forge, dans quel esprit, sont-elles nées ? L’exposition qui se tient en ce moment au centre Pompidou de Metz répond avec une précision et une scientificité rares. À l’heure où nous écrivons, les plus curieux ont encore un mois pour s’y rendre et découvrir l’atelier intérieur de Sergueï Eisenstein (1898-1948), artiste total.
Loin des expositions paresseuses qui, des réalisateurs, ne montrent que des scènes répétées en boucles, assorties d’affiches et de photos de tournage, celle-ci creuse et ouvre sur l’histoire de l’art tout entière : elle met en scène Eisenstein l’homme de théâtre, l’historien de l’art, le dessinateur, le collectionneur, le théoricien, et, dans une moindre mesure, l’artiste officiel, le cinéaste aimé de Staline dont la carrière connaîtra des soubresauts liés au cynisme et à la tyrannie de ce dernier. De fait, l’exposition frappe avant tout par sa largesse et son amplitude. Les clichés les plus connus sont bien là, mais élargis et agrandis à tous les médiums que le cinéaste pratiquait et exploitait.
L’architecture du centre Pompidou de Metz s’y prête. À l’intérieur, les salles sont si hautes, si volumineuses que ce sont à peine des salles. On dirait une succession de ventres de baleine ou de cathédrales métalliques dont les scénographes ont mis en valeur les échafaudages