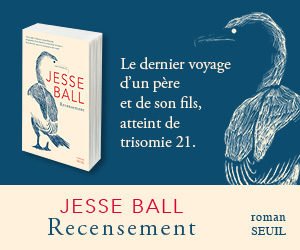Intelligence artificielle vs. intelligence romanesque — sur Une machine comme moi de Ian McEwan
Il y a les spéculations de prospectivistes ordinaires, traitant des grandes questions bioéthiques, ou plus largement sociétales, au premier plan desquels figurent le droit des robots, mais aussi les impôts sur les robots, dans les entreprises et ailleurs. Quelle place, plus généralement, l’intelligence artificielle (I.A.) va-t-elle être appelée à prendre dans notre vie de tous les jours ? Sans surprise, les réponses apportées accentuent l’angoisse ambiante.
Et puis il y a les trouvailles extraordinaires des romanciers de talent — Ian McEwan, en l’espèce, que l’on retrouve, avec Une machine comme moi, au sommet de son art, bien décidé, de façon à au moins remporter la première manche de la partie qui l’oppose à l’I.A., à déplacer les enjeux, à les tirer certes toujours du côté de la morale et de l’éthique, mais plus franchement dans la direction de l’intime. Comment diable peut-on en arriver à se montrer jaloux d’un robot, à lui envier ses performances, notamment sexuelles, à se montrer sensible à ses yeux pailletés de bleu ? Coucher avec un robot, est-ce être infidèle à son/sa partenaire ? Le tuer fait-il de vous un assassin ?
En surplomb de ce roman situé dans le Londres des années 80, mais qui ne fait retour vers un passé improbable pour mieux envisager un avenir qui semble tracé d’avance, trônent deux cerveaux. Le cerveau du robot Adam, belle mécanique intellectuelle, aux rouages bien huilés, d’une incroyable efficacité énergétique, d’une contenance d’un litre et climatisé, « sans la moindre surchauffe ». « Le tout pour vingt-cinq watts—comme une ampoule de faible luminosité ».
En regard, littéralement, se trouve le cerveau du romancier, méta-cerveau en quelque sorte, d’où est sortie tout armée cette histoire singulière. Cerveau nourri par ses lectures (Philip Larkin, Milton, Shakespeare, Joyce, Virgile…), ses affinités, sa petite musique personnelle (passent dans ce livre de nombreux échos de romans antérieurs, Expiation, Dans une coque de noix, L’Int