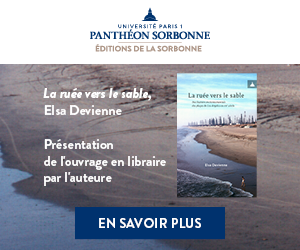Usine Luca – à propos de l’exposition Ghérasim Luca, Tourbillon d’être
L’œuvre protéiforme, multiple, hybride de Ghérasim Luca (1913-1994) pose avec une acuité particulièrement intéressante l’inlassable question des hypothétiques et fantasmatiques territoires de la poésie, et partant, de son statut, de ses limites, de ses rebords, de ses rebonds. La riche exposition que consacre la librairie Métamorphoses à cet « apatride » (d’origine roumaine, Luca s’installe définitivement en France dans les années 1950) surchauffe avec beaucoup de pertinence cette interrogation, ce doute. Car découvrir comme en paysage 3D – exposer de la poésie façonne un paysage 3D – les travaux du poète appelle immédiatement cette question a priori, a priori seulement, tautologique : qu’est-ce que la poésie ? Air connu.
Mais reprenons… Formellement, les canons académiques hérités des Anciens – canons qui permettaient une reconnaissance immédiate de l’objet poème à la vertu d’un certain nombre de dispositifs strictement contrôlés (vers, mètre, rime, etc.) – se sont peu à peu dilués dans la modernité inaugurée au milieu du XIXe siècle par Bertrand, Baudelaire, Nerval, puis Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé, etc, jusqu’aux explosions de ce que l’on a communément appelé les avant-gardes du siècle suivant, à commencer par les futuristes et Dada.
Poèmes en prose, vers libre, jeux typographiques, puis poésie sonore, visuelle, hybridations diverses (avec le son, l’image, le graphisme), gestes inédits (le collage – bientôt le cut-up –, le détournement, le ready-made, la performance, etc.) s’étaient attaqués à la vaste mission de rendre leur liberté aux mots et d’interroger autrement le monde et les battements de langue censés le dire, ou le non dire.
Ces bouleversements sollicitant de la part du récepteur un constant ajustement de la focale, c’est-à-dire obligeant à de nouvelles façons de lire, et donc aussi de regarder, et donc aussi, conséquemment, de « faire de la poésie » (formule nettement pléonastique si l’on se souvient que le poïèn grec d’où vient le terme