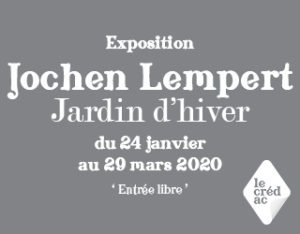La double-vie d’un film – sur Plogoff, des pierres contre des fusils de Nicole Le Garrec
Les images sont saisissantes : un tranquille village noyé sous les fumées, zébré de scènes de guérilla urbaine opposant des escouades en uniformes et en armes à des gens ordinaires, papis et mamies, jeunes, ouvriers, pêcheurs, paysans… Un check-point à Gaza ou Ramallah ? Belfast dans les années de guerre civile ? Un rond-point de la France de 2018 ? Non, Plogoff, vers la pointe du Raz, bout du bout de la Bretagne, en 1980, sous Giscard.
Le conflit était d’une simplicité biblique : les habitants de la région refusaient qu’on y installe une centrale nucléaire. Ce type de conflits locaux était fréquent dans les années soixante-dix : on se souvient des affrontements à Creys-Malville, pour les même raisons atomiques (« nucléaire, non merci ! » était le slogan de l’époque), ou du long combat du Larzac contre l’implantation d’un camp militaire sur le plateau. Éternelle tension girondino-jacobine entre des intérêts locaux et des décisions d’intérêt national (notion toujours à débattre) prises par le pouvoir central et centralisateur.
Nicole Le Garrec avait planté ses caméras à Plogoff durant les six semaines du conflit, et la première chose que l’on remarque en découvrant son film quarante ans après, c’est son intelligence et sa modernité de réalisatrice de documentaire : pas de commentaire, pas de voix off en surplomb, pas de synopsis écrit à l’avance, mais une confiance totale dans les images prises sur le vif et en immersion, dans le montage, et dans l’attention du spectateur. De ce point de vue, Plogoff, des pierres contre des fusils s’inscrit dans la meilleure veine de l’histoire du cinéma documentaire, celle de Frederick Wiseman ou de Johan Van der Keuken.
L’autre impression générale qui marque le spectateur quarante ans après la réalisation de ce film, c’est son effet « vintage » (l’auteur de cet effet est l’écart temporel plutôt que Le Garrec). Comme toute image de son époque, Plogoff… est un document précieux sur les années soixante-dix, sur ses enjeux p