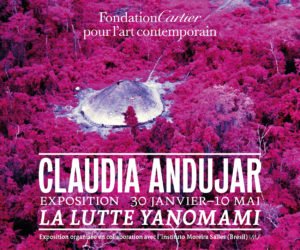Syrie : les mots au-delà des ruines
La littérature syrienne connaît une effervescence nouvelle alors que le pays est toujours en proie à une situation dramatique. En atteste la présence remarquée cet hiver d’écrivains syriens dans les programmes des éditeurs français dont, parmi les plus talentueux, Mustafa Taj Aldeen Almosa et son recueil de nouvelles fantastiques, La Peur au milieu d’un vaste champ, et Mamdouh Azzam, avec un roman en milieu druze, L’Échelle de la mort, tous deux dans la collection Sindbad chez Actes Sud.
« Un rat pâle avait pu se glisser là par le robinet. Fourbu, il venait d’essuyer une goutte d’eau tombée sur son museau, alors qu’il s’extirpait du robinet. Il contempla le lieu un instant mais il soupçonnait instinctivement l’ambiance de ce sous-sol et ne put en apprécier ni l’odeur ni le noir qui y régnaient. La pluie qui avait ruisselé abondamment dans les rues pendant la nuit l’avait empêché de poursuivre son trajet. Il avait décidé malgré lui de passer la nuit dans le premier asile qu’il trouverait inoccupé. “Mais où suis-je ?”, se demanda-t-il avec nostalgie. »
Ces lignes sont extraites d’une des nouvelles réunies dans La Peur au milieu d’un vaste champ, de Mustafa Taj Aldeen Almosa. Certaines caractéristiques peuvent y être relevées : le fantastique (le rat doté d’un logos), l’atmosphère mortifère (le sous-sol, le noir), un parfum d’exil, une écriture subtile (« un rat pâle »), bien servie par la traduction. Ce sont là quelques traits emblématiques de ce livre très impressionnant signé par l’un des nouveaux représentants de la littérature syrienne.
Mustafa Taj Aldeen Almosa est né en 1981 dans la province d’Idlib, une des régions martyres de la Syrie, aujourd’hui au bord de la catastrophe humanitaire. Contraint de fuir – il vit aujourd’hui à Istanbul –, il fait partie de ces millions de personnes qui ont dû s’expatrier au Liban, en Jordanie, en Turquie ou en Europe, dont de nombreux écrivains. Après une période où la censure s’est avérée moins efficace en Syrie, da