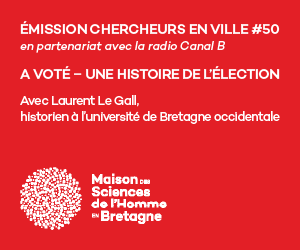Il y a quelque chose d’érotique à sauver la littérature – à propos de Warum de Pierre Bourgeade
Au dos du livre : « Vingt ans après – et alors que l’époque a révisé tous ses critères de jugement moraux et esthétiques – Warum paraît encore plus transgressif. Une nouvelle génération saura-t-elle s’en emparer ? »
Ma première interrogation, en forme de préjugé et d’horizon de contre-attente du roman, concerne le récit érotique que constitue Warum. Si par « transgressif » les éditeurs faisaient allusion à l’érotisme, réputé cru, parfois violent de l’œuvre, une récente lecture performée d’un texte érotique de Bataille m’avait au contraire laissé penser qu’à force d’être travaillé comme principe de subversion, l’érotisme a aujourd’hui largement perdu de sa force de déflagration transgressive – Bataille et Sade ont trouvé leur place dans la littérature classique, parmi les monuments littéraires de notre culture.
Par nature, l’érotisme induit effectivement une transgression, dans la mesure où il s’agit d’une représentation esthétique visant à contaminer le réel en suscitant le désir, déborder le cadre de la représentation et l’abolir. Mais de cette transgression essentielle découle une trop grande facilité – parfois une lourdeur – du langage érotique, et en conséquence une grande difficulté à le mettre en œuvre en dehors de cette mécanique attendue.
Ce qui m’avait finalement dérangée dans cette interprétation du texte de Bataille, c’est qu’il s’y oubliait ce que ce fragment avait déjà de performatif : la performance intervenait ainsi en forme de redondance, en ramenant l’ensemble au ronronnement tranquille de la représentation – bien loin de toute déflagration. Je crois qu’à lire à voix haute ou à incarner par le geste, le Bataille des essais philosophiques est plus percutant que celui des fictions érotiques – parce que l’érotisme est un langage à part entière, nécessairement disruptif lorsqu’il est invité dans une autre forme, celle de la performance comme celle d’une narration, qu’il peut facilement éclipser.
L’œuvre de Pierre Bourgeade qu’il projetait d’a