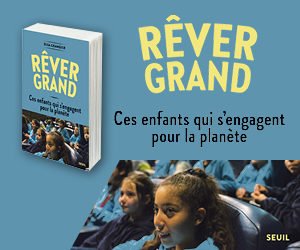Le vrai du faux – sur le Journal de l’année de la peste de Daniel Defoe
Matière littéraire
Cinquante-sept années se sont écoulées depuis les ravages causés par la peste bubonique de 1665-1666. Il faut pourtant croire qu’il y a urgence, de la part de Daniel Defoe, l’auteur de Robinson Crusoe (1719), à y revenir. C’est qu’une autre peste menace – toujours l’épidémie fait retour, nous rappelle l’Histoire. Sous les initiales H.F. (pour Henry Foe, oncle de l’écrivain), il fait paraître un Journal destiné à documenter la nocivité d’un fléau qui fit 100 000 morts, loin des chiffres officiels faisant état de 68 000 victimes. Pour la postérité, et de manière à prévenir une récidive, il stigmatise l’impréparation des autorités et s’émeut de l’aspect « inédit » d’une métropole fantomatique vidée de ses habitants.
La soi-disant objectivité de la démarche, journalistique dans le choix de la forme, ne tient pas longtemps. Tout dans la Capitale de la douleur et des larmes est « extrême » : passion, agonie, désespoir, terreur. Les bubons logés dans l’aine ou au creux des aisselles gonflent et l’inflammation provoque des souffrances effroyables, à l’origine de comportements paroxystiques. La peste pousse à la folie furieuse des grands délirants. Double peine. Âgé de cinq ans à l’époque, Defoe reconstitue plus qu’il ne se souvient. L’intensité des sensations à vif, malgré la distance temporelle, côtoie la rigueur des données collectées sur le terrain.
À chaque coin de rue naissent des histoires, plus « extraordinaires » les unes que les autres. Histoires de cas, au sens de la clinique, mais elles sont bien plus nombreuses à se présenter comme des embryons de récits, qui avortent presque systématiquement. Histoires particulières de sacrifice ou d’égoïsme à la véracité non garantie, « microfictions » (Régis Jauffret) interpolées, elles pullulent dans ce bouillon de culture, à l’image des diaboliques créatures microscopiques à l’origine, dit la vox populi, de la propagation du fléau par la salive ou les « effluves ».
La préparation du roman est e