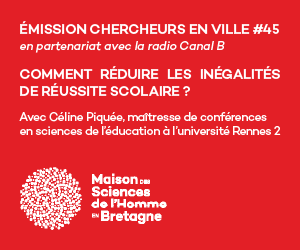Réalité et viralité — à propos de La Guerre des mondes de H.G. Wells
On se souvient du scénario développé par H.-G. Wells dans La Guerre des mondes : des extra-terrestres doués d’une intelligence très supérieure à celle des hommes préparent l’invasion et la destruction de la terre en observant ceux-ci pendant des dizaines d’années depuis l’espace. Quand ils débarquent dans leurs fameux tripodes métalliques, c’est le carnage. Les extra-terrestres se nourrissent du sang des hommes, ils tuent environ la moitié de la population humaine avant de mourir à leur tour, victimes de microbes qui ont échappé à leurs facultés d’observation, et contre lesquels ils ne sont pas immunisés.
Dans ce scénario, c’est seulement pour les abominables extra-terrestres que les microbes sont un ennemi invisible, comme on le dit aujourd’hui un peu partout. Ils viennent d’être découverts et il leur arrive d’être les alliés des hommes, qui les fréquentent depuis longtemps et qui ont par conséquent eu le temps de s’immuniser. Ce sont de gentils microbes en somme (comme on dit de gentils géants) qui échappent aux stratégies de visibilité sur lesquelles s’appuient les cruels envahisseurs. Ceux-ci n’ont pas vu ce qui n’est observable que dans les microscopes et les éprouvettes de Pasteur, de Koch et de tous les autres qui viennent de s’y mettre.
Paru en 1898, le roman de Wells a le sens d’une profession de foi en la science, typique pour l’époque. Il prend acte de l’essor de la microbiologie, qui donne de nouveaux et très sérieux arguments à ceux qui opposent la science et la vérité à la superstition et la croyance. Parfois considéré comme le Jules Verne britannique, Wells a en effet un pied dans la science-fiction, dont il est un des inventeurs, mais un autre dans le discours utopique (et parfois dystopique), dont on sait qu’il lui est souvent arrivé de convoquer la science à l’appui de l’invention de nouveaux modèles sociaux.
En ces temps de confinement où le temps s’arrête, les actualisations intempestives sont sinon légitimes, du moins font-elles passe