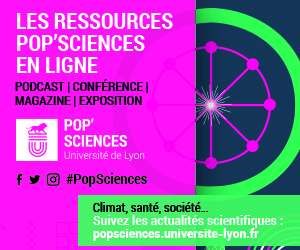Guerre d’occupation et morts en série – sur La Peste d’Albert Camus
On croyait connaître La Peste de Camus, grand roman fondateur de l’après-guerre paru en 1947, et puis on le relit alors qu’on est confiné contre le Covid, et on tombe sur cette phrase de Daniel Defoe mise en exergue par Albert Camus : « Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d’emprisonnement par une autre que de représenter n’importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n’existe pas » [1]
On se rappelle alors que Camus a conçu La Peste pendant la Seconde Guerre mondiale comme une trilogie de l’absurde, avec Les Justes créée en 1949 et L’Homme révolté paru en 1951 : un roman, une pièce de théâtre et un essai philosophique pour dire, au sortir de la guerre, le choix entre être et ne pas être. Mais alors que la pièce situait ce choix face à l’attentat terroriste et l’essai face au suicide, le roman le situe face au confinement – trois visages du nihilisme moderne. « Suicide et meurtre sont ici deux faces d’un même ordre, celui d’une intelligence malheureuse qui préfère à la souffrance d’une condition limitée la noire exaltation où terre et ciel s’anéantissent » [2]
L’expérience du confinement fait basculer la fiction dans le réel. Elle insère dans ce printemps 2020 l’imaginaire des périodes de guerre : la déclaration martiale d’Emmanuel Macron, mêlant les accents de Clemenceau et de Jaurès, rejoint le souvenir de la « drôle de guerre » suivie de l’occupation allemande. Nous serions confinés chez nous par un ennemi invisible venu de Chine, comme nous l’avons été lorsque l’armée allemande se battait contre nous dans des tranchées ou occupait nos villes et nos villages – mais cette fois l’Allemagne accueille nos patients et la Chine nous envoie des masques. Il est alors « raisonnable de représenter une espèce d’emprisonnement » comme « quelque chose qui n’existe pas », pour nous poser la question : qu’est-ce qu’une « guerre d’occupation » quand l’ennemi est un microbe ?
Roland Barthes a reproché à Albert Camus, à la suite de la