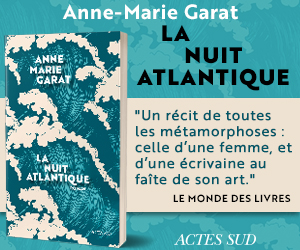« Partir, c’est mourir un peu. Arriver, c’est ne jamais arriver » — sur deux livres de Valeria Luiselli
Parmi le flot de voix qui se sont élevées ces dernières semaines pour raconter leurs expériences du confinement, entre chroniques désœuvrées des réfugiés du bocage et colère sociale des personnels soignants, il y a celles, presque inaudibles, des mineurs isolés étrangers. Le 4 avril dernier, l’un d’entre eux, Mohamed Lamine Camara, lançait un appel à l’aide déchirant sous la forme d’un message posté sur les réseaux sociaux. Il y expliquait comment la veille, jour de ses dix-huit ans, il avait été mis dehors par l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
« Pour que vous compreniez, poursuivait-il, je dois vous raconter mon histoire », avant d’engager un récit qui débutait deux ans plus tôt, en Guinée où, avec sa sœur aînée, il avait entrepris un voyage aussi périlleux qu’incertain, à travers le Mali, le Burkina-Faso, le Niger, et la Libye. Elle, comme beaucoup d’autres femmes et jeunes filles, ne devait jamais arriver jusque sur les côtes européennes, enlevée en Libye sous les yeux de son frère. Lui, secouru par des anonymes et des associations, parvenait tant bien que mal à Marseille, et entamait un autre périple, administratif et labyrinthique celui-ci, dans l’espoir d’obtenir un statut légal.
Raconte-moi la fin
En lisant le témoignage de Mohamed Lamina Camara, je pensais à un livre de l’écrivaine mexicaine Valeria Luiselli, Raconte-moi la fin, traduit en français en 2018 aux Éditions de l’Olivier. Un livre plein d’histoires comme celle-ci, toutes semblables et pourtant toutes irréductiblement singulières. Ces récits, Luiselli les a recueillis tandis qu’elle travaillait bénévolement comme interprète auprès d’un tribunal de New York chargé d’étudier les demandes d’asile des mineurs isolés étrangers entrés illégalement sur le territoire américain. On est en 2015 et l’administration est débordée par l’afflux continu d’enfants, parfois très jeunes, qui franchissent la frontière du Mexique et des États-Unis juchés sur des trains de fret, « La Bestia » comme ils l’appe