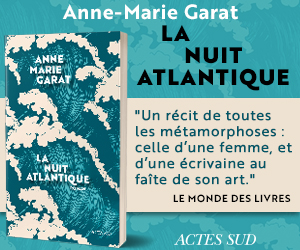Souffle ténu du printemps – sur Le Paradis d’Alain Cavalier
Il y a cette maladie du confinement qui consiste à ne pas pouvoir ouvrir un livre, ni vieux ni neuf : maladie du lapin dans les phares du télétravail, besoin de se sentir utile, productivité aggravée, blocage de tout projet : le sentiment d’une urgence qui patine à vide, et comment pallier. Surchauffe du moteur de partage : médias sociaux à tout va, live Instagram, fabrique de galerie 3D, cours sur tous les Discord et Jitsi Meet possibles… Peut-être est-ce une maladie propre à ceux dont l’existence consiste à créer ou transmettre. Machines intersubjectives en train de cramer un fusible.
Où l’on s’aperçoit que, malgré tout, comme pour un enfant récalcitrant, ouvrir un livre demande un soupçon plus d’action que regarder un film ou écouter une symphonie. Non que l’appréciation soit possible dans une passivité réelle, mais disons que, devant une image ou un son, on peut – sans être non plus « absorbé » – se relâcher un brin. En tous cas, si je n’arrive pas pour ma part à ouvrir un livre, à l’instar de certains collègues enseignants ou critiques (il y a aussi très logiquement les écrivains qui ne peuvent pas commencer un livre), je peux encore regarder un film. Au cas où, atteint de la même maladie, vous n’auriez pas essayé, c’est le moment. Il se trouve par ailleurs que j’étais depuis quelques mois pris d’une passion curieuse pour Le Paradis (2014) d’Alain Cavalier. Très vite ce film m’est devenu un fétiche, un single en boucle. Je le recommandais comme on offre un livre à tout va, afin d’évangéliser mes amis.
La première semaine de confinement a ainsi vu resurgir en moi le démon de la pédagogie, mais quelque peu sadique. Je le donnais en modèle : « Toi étudiant·e en cinéma qui geint de ne pas pouvoir réaliser douze minutes de film à moins de cinquante mille euros, regarde comment on fait un chef d’œuvre avec rien. » Et même sans presque sortir de chez soi. Il suffit d’un intérieur et d’un extérieur, de jour et de nuit. J’omettais, pour ne pas être totalement