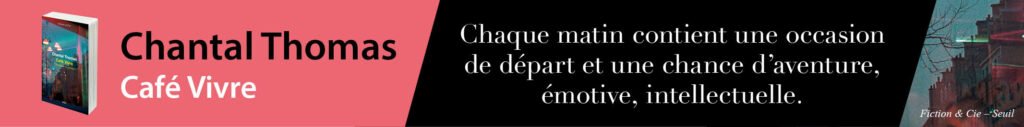Les aventures émotionnelles et politiques du « spectateur zéro » – à propos d’une conversation entre Yann Dedet et Julien Suaudeau
Yann Dedet exerce, depuis plusieurs lurettes, la noble activité de monteur de film. Dans un livre d’entretiens avec l’écrivain et documentariste Julien Suaudeau, il évoque son expérience, et les multiples rencontres qu’elles ont occasionnées, dont de longs compagnonnages avec trois figures majeures du cinéma français, François Truffaut, Maurice Pialat et Philippe Garrel. Dedet, qu’une longue amitié lie à Jean-François Stevenin, dont il a monté les deux premiers films, et au regretté Patrick Grandperret, a également travaillé aux côtés de nombre des cinéastes des générations suivantes, dont Claire Denis, Alain Guiraudie, Pascale Ferran, le tandem Pierre Trividic-Patrick Mario Bernard et, plus fréquemment qu’aucun autre, Cédric Kahn.
Très peu d’étrangers, mais tout de même deux personnalités de première grandeur, Dusan Makavejev et Amos Gitai. La verve, l’honnêteté sans précautions excessives, la conscience à vif des enjeux éthiques et politiques qu’impliquent les relations de travail comme les choix esthétiques, suffiraient à faire du Spectateur zéro un ouvrage passionnant. Mais il y a plus.
Pour une vision du monde, penser avec les mains
On sait depuis très longtemps, disons depuis Eisenstein, que le montage n’est pas seulement une étape technique importante de la mise en forme des films mais un analyseur essentiel de la compréhension du processus cinématographique, et au-delà, de ce qu’est la construction d’une « vision du monde ». D’où l’importance intellectuelle, bien au-delà du manuel d’utilisateur, de nombreux textes consacrés à la question, parmi lesquels ceux des grands auteurs soviétiques (Eisenstein donc, mais aussi Vertov, Koulechov, Poudovkine), ceux de grands théoriciens (Epstein, Bazin, Deleuze, Daney, Aumont), de cinéastes (Godard, Pasolini, Tarkovski, Van Der Keuken, Wiseman…) et bien sûr de monteurs (Henri Colpi, Walter Much, Claire Atherton, Emmanuelle Jay).
La HEAD, école d’art genevoise, a publié en 2018 un imposant et précieux florilèg