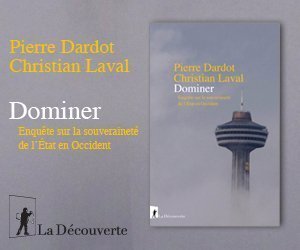Et idola penitus conterentur – à propos des deux derniers albums de Kanye West
Dans son cercueil, Sarah Bernhardt semble être en pleine forme. La tête relevée par un petit coussin, le cadavre est placé dans la diagonale de la chambre mortuaire et traverse en oblique le portrait de la défunte. Son teint est étonnamment vif, l’attitude d’une sérénité désarmante. L’exposition de l’image détache cette silhouette radieuse de l’espace dans lequel elle repose.
Les statuettes marbrées et le bougeoir qui se dressent à proximité du coffin ne sautent pas aux yeux tant l’attention est saisie par cette plaie centrale, une incise si purement blanche que l’on peine d’abord à discerner les bras croisés de l’actrice dans les plissures de l’étroit linceul qui la protège et que recouvrent quelques couronnes fleuries. N’en réchappe que ce visage apaisé et gracieux, délicatement coiffé, d’une jeunesse visiblement éternelle. Pourtant, à bien y regarder, la date inscrite en marge du cliché laisse planer un doute.
La photographie posthume de Sarah Bernhardt a été prise dans ses appartements parisiens en 1881, soit trente-huit ans avant que l’actrice ne décède pour de bon au terme d’une longue agonie, amputée de la jambe droite, le corps ravagé par la tuberculose et une dernière crise d’urémie. Celle qui avait coutume de se reposer dans ce cercueil capitonné en bois rose le temps de siestes qui inquiétaient tout son entourage avait donc choisi d’orchestrer la mise en scène macabre de son propre deuil.
J’ai découvert cette image au cours du deuxième chapitre de Dying on Stage, la performance présentée par Christodoulos Panayiotou au musée d’Orsay pendant le Festival d’Automne. Au fil de cette conférence en trois temps, l’artiste chypriote commente des vidéos glanées sur Youtube allant de Rudolf Noureev à Grégory Lemarchal en passant par Anita Cerquetti, David Lynch ou bien sûr Dalida pour ébaucher une dissertation intuitive sur les figurations médiatiques de la mort en Occident.
Plus tôt, cet après-midi-là, j’ai traversé Paris à pied en tâchant d’arriver pi