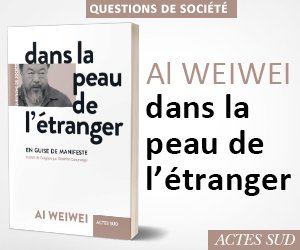Chantier interdit au public – à propos de Manifesta 13
Il fallait ouvrir. Pour Marseille, parce que c’est Manifesta, pour les artistes présents et aussi pour qu’une biennale d’art contemporain post-Covid se tienne avant 2022. En cela, il est des manifestations et des expositions qui peuvent parfois se transformer en chantier pour une re-construction d’ampleur. C’est le cas de Manifesta à Marseille, du fait de sa programmation premièrement, mais aussi des orientations de l’équipe curatoriale (Alya Sebti, Katerina Chuchalina et Stefan Kalmàr), et enfin du fait de contingences aujourd’hui évidentes, lesquelles donnent à cette édition de la biennale européenne itinérante[1] des airs de catalyseur des problématiques culturelles, sanitaires et des enjeux internationaux. Alors, Manifesta 13 nous offre une plongée inédite dans le chantier culturel des mois et des années à venir.
« Marseille est marquée par les transitions : lieu d’arrivées et de départs continus, à la fois échappatoire et sanctuaire. Mais Marseille est aussi l’incarnation de résistances car souvent le théâtre de moments uniques de tensions fécondes. Marseille est une ville exceptionnelle au sein de la matrice européenne puisqu’irrésolue – une ville en perpétuel mouvement, tournoyant autour de multiples centres, aussi bien historiques qu’informels. Ses innombrables histoires, biographies et anecdotes donnent forme à ses multiples existences. Marseille résiste à toute tentative de catégorisation, sa singularité résidant dans son identité hétérogène. »[2]
Les géographies de l’art
En effet, peu de manifestations n’auront été attendues avec autant d’impatience et d’espérance dans le champ des arts visuels et des sciences humaines que cette nouvelle édition de Manifesta, la première à avoir lieu en France. Mise sur rails dès 2016, les quatre années de préparation ont su éveiller de nombreuses questions et ambitions autour d’une équipe locale et internationale marquée durant ces derniers mois par le confinement, la distanciation sociale et internationale,