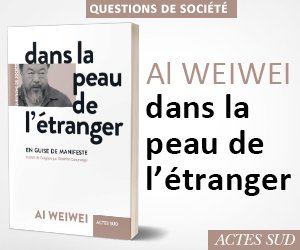Une femme qui dort – à propos d’ Énorme de Sophie Letourneur
Le moins qu’on puisse dire est qu’Énorme n’est pas un film simple. Il ne se prête à aucune interprétation univoque, on sort avec un goût trouble de sa projection. La raison en est sans doute que son héroïne est la plupart du temps mutique, que ses motivations restent obscures aux spectateurs·trices. Contrairement à ce qu’indique son prénom, Claire n’a rien de clair – à moins qu’il ne faille supposer au contraire qu’elle est littéralement toute-claire, entièrement contenue dans sa surface et sans rien au-delà. Ce qui n’en pose pas moins, et de façon plus complexe, la question de sa « vérité » fictionnelle.
Technique critique antique : réintégrer l’œuvre dans la série des films de l’auteure. On y reconnaîtra plusieurs thèmes récurrents depuis son premier court-métrage, La tête dans le vide (2004), dont la fatigue ou l’autonomie, mais déplacés et condensés, dilués, presque effacés et, paradoxalement, d’autant plus structurants.
Commençons par nous placer depuis la bêtise ordinaire du ou de la spectateur·trice : même si Enorme, comme son titre l’indique, se présente sous l’aspect d’une farce hénaurme – en plus de faire référence au ventre de l’héroïne –, le mélange de documentaire et de fiction sur lequel il repose tend, dans l’esprit du public, à le faire pencher du côté du « vraisemblable » ou du « réalisme » au sens technique. Le film s’est ainsi retrouvé dès sa sortie au centre d’une mini-polémique sur les réseaux sociaux, d’un moralisme à faire pâlir le procès de Mme Bovary et pilotée par un compte apparemment désireux de nuire à Marina Foïs : Enorme ferait l’apologie de la grossesse forcée et de l’entrave à l’IVG. L’acteur Jonathan Cohen a dû monter au créneau sur Twitter pour rappeler que les exactions de son personnage étaient ouvertement condamnées dans le film et désignées comme des délits.
Enorme est construit sur le principe du monde renversé.
Dire qu’une œuvre « condamne » ou « approuve » les actions ou discours de ses personnages suppose un géni