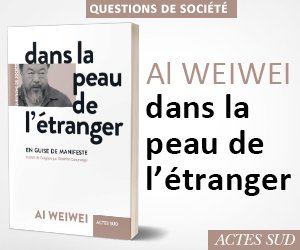Boire et déboires – à propos de l’album Boire de Miossec
Petit message aux plus jeunes d’entre vous. Pour écouter de la musique avant le streaming, il y eut le vinyle puis le CD. Et entre les deux, on utilisa ces petits objets fragiles, saturés et salvateurs : les cassettes. La cassette fut longtemps, avant les lecteurs MP3, le format-roi de la musique en mouvement, à emporter. On se faisait des compilations calées à la seconde près (on utilisait le format 90 minutes), pour soi ou pour celles ou ceux qu’on essayait de séduire. Pour nous épauler, on envoyait au front nos chansons préférées du moment. Ça ne marchait pas souvent : on avait déjà des goûts tordus.
La cassette, pour un fan de musique, fut synonyme de liberté, d’émancipation. On pouvait voyager, se promener sans abandonner la musique à la maison. On ne remerciera jamais assez l’inventeur de l’autoradio-cassette et du Walkman pour avoir autorisé la musique de nous accompagner partout, tout le temps.
Avec une poignée de copains de classe aussi fous de musique que moi, on enregistrait ainsi chaque soir l’émission de Bernard Lenoir sur France Inter. Le lendemain, on débriefait l’émission et souvent, on séchait les derniers cours pour courir acheter un album entendu la veille. J’ai longtemps ainsi connu la voix de Bernard Lenoir sur cassette. Quand je lui ai parlé pour la première fois, son timbre n’était pas le même, moins grave, plus écrasé, moins urgent. Mon magnétophone ne tournait pas à la bonne vitesse.
Pour sa première, Miossec imposait déjà sa présence : perturbateur, provocateur, trublion. Sa cassette était un virus. On ne s’en est jamais remis.
Une vingtaine d’années plus tard, devenu journaliste, j’étais régulièrement invité dans l’indéboulonnable émission du même Bernard Lenoir. J’étais chargé de défricher la musique anglaise, d’en ramener la crème de la crème, comme disent les Britons pas trop brexités. Je venais dans son studio, en ces années 90 fertiles, avec un sac rempli de 45 tours, de CDs. Les cassettes avaient été envoyées à la casse, à