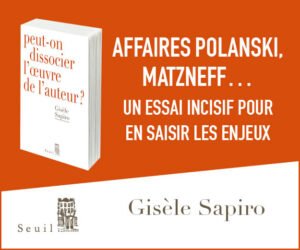Sur la deuxième vague des séries américaines féministes
Ruth Bader Ginsburg, juge mythique de la Cour suprême américaine disparue en septembre dernier, grande progressiste et féministe dont le Sénat républicain vient de confirmer le « remplacement », avec une rapidité indécente, par la juge et militante anti-avortement Amy Coney Barrett, était une icône de la culture populaire : « The Notorious RBG » – surnom parodiant celui du grand rappeur Notorious B.I.G. – fut évoquée dans la série Big Bang Theory (S12, E6) ou encore imitée par Kate McKinnon dans Saturday Night Live. Elle a été le sujet de deux films en 2018 : le documentaire de référence RBG (de Betsy West et Julie Cohen) et le biopic Une femme d’exception (On the Basis of Sex, de Mimi Leder, une réalisatrice bien connue d’Urgences à The Leftovers).
RBG y est interprétée par la star Felicity Jones (qu’on a vue en héroïne de Rogue One). Le film décrit sa formation, sa relation avec son mari (Armie Hammer présent dans The Social Network et Call Me by Your Name, où il est excellent en époux résolument féministe), ses difficultés pour trouver un travail après ses études de droit, et sa première grande affaire.
Le personnage de RBG fait aussi une micro-apparition sous les traits de Tara Nicodemo dans la brillante mini-série Mrs. America (Dahvi Waller, FX, 2020), dans l’épisode « Phyllis & Fred & Brenda & Marc » (titre hommage au film de Mazursky de 1969, Bob & Carol & Ted & Alice), centré sur un beau personnage d’avocate féministe, Brenda Feigen (Ari Graynor), laquelle fut aussi une des étudiantes pionnières à la Harvard Law, mais évoquant aussi les luttes LGBT présentes dans les mouvements féministes des années 1970. Le destin fictionnel de RBG est un exemple des interactions de la culture populaire et de la politique.
Générations féministes
L’époque est aux séries féministes, qui ont connu un développement explosif depuis #MeToo. Chacun peut se rendre compte de l’évolution, peut-être irréversible, qui a mis les femmes au premier plan du petit écran. Déjà, d