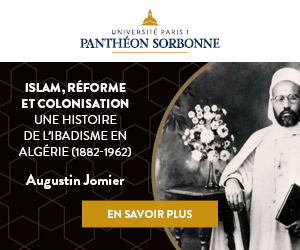Cinéma : commerce et confinement
Avant la mise à disposition d’un vaccin, proche nous l’espérons, les confinements imposés en réponse à la pandémie empêchent l’exercice du cinéma en salle et bouleversent, du coup, la « place du spectateur ». Les festivals de cinéma, hauts lieux d’une cinéphilie ouverte, se sont résolus, à l’exception de Cannes, à passer en ligne, à aligner, donc, les films sur des écrans – télévisions, ordinateurs, téléphones portables – bien plus petits que ceux des salles. La question de la taille de l’écran est décisive : dans les salles de cinéma, il est plus grand que celles et ceux qui le regardent, ailleurs, non. La numérisation des films a certes permis de réduire considérablement la machinerie des projections sur grands écrans, dans de « vraies salles » – mais c’est précisément le problème en temps de confinement.
Passant au « petit » écran, il est clair qu’on rapproche le cinéma des films et séries télévisés. Et si l’on en croit les avertissements de tous les festivals de cinéma (fiction et documentaire), ce passage est douloureux. On regrette, on se plaint, mais on migre quand même. Il y va du maintien du nom du festival, de sa notoriété, de sa nécessité, enjeux de taille, qu’il faut sauver en ces temps mauvais, fût-ce au détriment de ce qui s’appelle « cinéma » et qui suppose un regard-spectateur engagé.
Même dans un festival, qui est d’abord exposition des films choisis, il est possible que spectatrices et spectateurs rencontrent – pour de vrai, dans des projections en salle – des films qui les touchent, qui les changent, qui leur font voir le monde et leurs contemporains autrement. Sinon, pourquoi le cinéma ? Paillettes et tapis rouges ou pas, ce sont les films qui peuvent changer celles et ceux qui les regardent.
Il est à redouter que les migrations du cinéma hors des salles n’annulent l’intensification des vies filmées qui a lieu sur ces écrans plus grands que nous.
La taille réduite des écrans de secours (« faute de mieux »), les rendant maniables et por