Trente-six vues contre-révolutionnaires – sur La Maison du mystère d’Alexandre Volkoff
1. « Pendant La Maison du mystère elle a eu une conduite scandaleuse et attentatoire : elle voulait à toute force prendre la salle entière à témoin qu’elle trouvait Mosjoukine à son goût. “J’veux qu’il m’fasse un petit”, qu’elle criait ; enfin des propos comme on n’en tient pas dans les bals-musette des Épinettes. » Mademoiselle Perlouett, héroïne de cette fable misogyne, n’existe pas. Elle a été inventée pour une chronique cinématographique du Journal Amusant datée du 28 avril 1923 et intitulée « Les Opinions de Vincent Gédéon ».
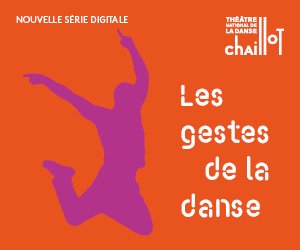
2. Joseph Machabert existe. C’est Myriam Juan qui l’a retrouvé pour son article sur Mosjoukine paru dans la précieuse revue 1895. Machabert, vingt ans, est ouvrier ébéniste, il écrit à Mosjoukine une lettre sur trois feuilles à carreaux pour classeur, qu’il envoie à Ciné-Miroir en 1928. Il habite au Puy-en-Velay, dans le Massif Central, « avec tous ses vésuves éteints », écrit-il en citant George Sand. Il se dit « sensitif, ami des arts ». Il a découvert son idole deux ans plus tôt dans Kean d’Alexandre Volkoff : « Telle une pieuvre embrasse sa proie, vous aviez capté l’attention des spectateurs. » Le jeune homme collectionne tout ce qui s’écrit sur son « cher Ivan Ilitch », va voir tous ses films et il a commencé à peindre un portrait de lui. Hélas, comme nous sommes en 1928, il ne connaît l’acteur qu’en noir et blanc, ce qui n’est pas pratique pour faire les cheveux, les yeux, la peau, etc. Ivan pourrait-il lui faire parvenir une photo de lui en couleur ? Et quand Joseph aura fait le portrait, il lui faudrait l’adresse privée de l’acteur : pour le lui envoyer, ce serait mieux. Sans doute déçu de ne pas avoir de réponse, Joseph apprend plus tard que Ciné-Miroir n’a pas reçu sa missive. Il la recopie donc et l’inclut dans un autre courrier. Dans ce dernier, il ajoute quelques mots : « Voici la lettre que j’avais écrite. […] Je n’avais pas jugé nécessaire de vous dire que j’étais marié. Il en est cependant ainsi et, depuis bientôt
