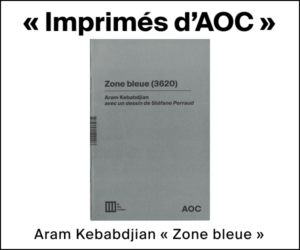« Une éruption où le monde paraît » – sur la poésie de Louise Glück
En octobre 2020, à l’automne dernier donc, l’Académie de Stockholm attribuait à Louise Glück le Nobel de littérature, venant couronner une œuvre sobre, mais néanmoins riche d’au moins douze recueils, déjà largement saluée par toutes sortes de prix et de distinctions internationales. Pourtant, l’aura de l’inclassable poète américaine n’avait pas atteint les rivages de la France, si bien qu’à quelques exceptions près, Claude Mouchard en tête, on se trouva fort démuni pour en parler.
En avril 2021, coïncidant avec l’arrivée du printemps, deux recueils paraissaient chez Gallimard, L’iris sauvage, traduit et préfacé par les soins de Marie Olivier, et Nuit de foi et de vertu, traduit et présenté par Romain Benini. Avril, le mois « le plus cruel », si l’on en croit T.S. Eliot, sur lequel Glück a écrit, car engendrant « des lilas qui jaillissent de la terre morte, il mêle / Souvenance et désir, il réveille / Par ses pluies de printemps les racines inertes ». Parution doublement de saison, donc, tant la poésie glückienne en général, et L’iris sauvage en particulier, se donne pour tâche de méditer le mystère récurrent, cyclique, de la mort et de la renaissance du végétal, dans sa différence avec l’humain.
Chaque parution poétique, qu’elle soit ou non d’importance, et c’est clairement le cas ici, offre l’occasion de faire retour sur ce qui fait qu’un poème dispose de sa temporalité propre, laquelle finit toujours par trouver un espace pour sa réception. Inactuel, en dehors d’une allusion à la « quarantaine d’affliction » imposée par Dieu, le volume de 1992 n’est pas sans ressembler à ces « Perce-neige » qui y figurent en bonne place, parmi une dizaine d’autres espèces de fleurs. Prenant le « risque » de la joie, ils sont de retour parmi nous, chaque hiver, « dans le vent cru du nouveau monde ».
Pour le dire avec les mots d’Ezra Pound, la poésie, ce sont « des nouvelles qui restent des nouvelles », à jamais fraîches, ou disons encore qu’elles trouvent à chaque nouvelle saison