Comment le Festival de Cannes 2021 a su – ou pas – accueillir des monstres
«Merci au jury d’avoir laissé entrer les monstres», a dit Julia Ducourneau en acceptant la Palme d’or remise par Spike Lee, président dudit jury du 74e Festival, lors de la cérémonie de clôture le 17 juillet. La formule est belle, en ce qu’elle fait d’un film, et en ce cas du fait de le récompenser, des actes d’hospitalité, et d’hospitalité pour des êtres différents, et qui le plus souvent suscitent l’hostilité et la peur.
Le film, Titane, est bien en effet le lieu d’une telle opération ; le film non seulement met en scène des personnages monstrueux mais prend ouvertement leur parti. Il le fait d’une façon particulière, qui mérite d’être réfléchie. Et, en le faisant, il s’inscrit dans ce qui s’est révélé une tendance plus générale repérable dans la sélection cannoise, et notamment en compétition officielle. Mais, selon les films, la mise en œuvre de ces opérations d’accueil d’être différents et potentiellement menaçants ou effrayants s’active de manières très différentes et parfois antagonistes.
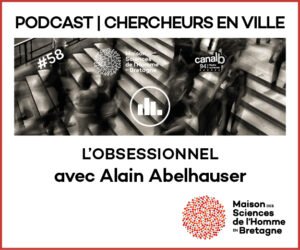
Un des poncifs qui a accompagné la présentation de Titane puis son couronnement concerne l’événement nouveau que serait la rencontre entre cinéma d’auteur et cinéma de genre, avec en arrière-plan la guerre rance menée depuis des lustres contre l’esprit de la Nouvelle Vague (esprit qui n’a en soi rien de français) et tout ce qu’elle représente comme liberté dans les infinies manières de filmer. Cette opposition film d’auteur/film de genre est simplement stupide et fausse.
Il suffit de songer aux rapports d’À bout de souffle (et tant d’autres) au film noir, de Lola (et tant d’autres) à la comédie musicale, il suffit de se rappeler l’influence d’Hitchcock sur Truffaut, la présence de science-fiction chez Resnais, etc., pour disqualifier cette approche. Ce que les promoteurs du soi-disant retour au « film de genre » revendiquent est beaucoup plus limité, et concerne un genre particulier, très en vogue notamment dans le public adolescent, le film d’horreur.
Là aussi on
