Poétique de la terre brûlée – sur Feu de Maria Pourchet
Ça commencerait presque comme une romance : elle, universitaire et mariée, s’ennuie sans trop se l’avouer. Lui vit seul avec son chien et déteste son métier de banquier. Sur la vague recommandation d’une connaissance commune, elle lui propose de participer à un colloque, afin d’apporter un regard extérieur sur la notion d’époque qui sera au cœur des débats. Ils se rencontrent : coup de foudre. Et, bientôt, le brasier. Sur ce scénario plus qu’éprouvé, Maria Pourchet élabore une chronique de la passion aussi éloignée de toute fadeur qu’un citron acide.
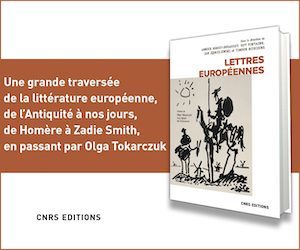
Ce qui saisit d’abord Laure lorsqu’elle rencontre Clément, ce sont ses mains, « incapables de l’étrangler », et une certaine forme de tourment qui lui évoque la peinture florentine où « les visages martyres se livrent en dedans le combat de l’ange et de la chair ». En guise d’émotion inaugurale, guère de joie ni d’émerveillement sans mélange : c’est d’emblée le corps qui parle, et la « peur » qui pousse les protagonistes l’un vers l’autre. La passion amoureuse se donne à lire comme une émanation viscérale, archaïque et primaire. Le soir même, à l’orée de l’embrasement, l’urgence fait écrire Laure à Clément : « J’ai envie de vous. »
Ce texto nocturne envoyé fébrilement du bord de la baignoire tandis qu’Anton, le mari, enjoint Laure de venir enfin se coucher, plante le cadre de l’histoire extraconjugale que Feu va développer, déployer et ausculter de ses origines jusqu’à son extinction, en passant par ses épisodes les plus ardents. Laure a rencontré Anton lorsque sa fille Vera, « née sans trace », avait 6 ans. En s’unissant à lui, elle a remplacé le duo fusionnel mère-fille par le rassurant cadre familial, les dîners de corn-flakes par des légumes bio, un studio à Parmentier par une maison à Ville-d’Avray, les angoisses de fin de mois par des projets de vacances. Puis Anna est née, l’enfant tranquille, aussi docile que Vera est depuis toujours indomptable. Laure, finalement, a trouvé « le repos qui appelle le t
