Peindre le temps – sur « David Hockney. A Year in Normandie »
« Dans la Bible et d’autres textes anciens, tout lieu important est un jardin. Où préféreriez-vous vivre ? Où voudriez-vous être ? »
David Hockney[1]
Début mars 2019, le peintre anglais David Hockney s’installe dans sa propriété de « La Grande Cour », acheté sur un coup de tête, non loin de Beuvron-en-Auge dans la campagne normande. En décembre 2019, il commence à peindre sur iPad une année de paysage autour de son terrain, soit 220 peintures jusqu’en janvier 2021. Quatre heures de neige tombée miraculeusement l’aideront à finir son cycle.
Outre trois grands formats composés de peinture par iPad au rez-de-chaussée, l’œuvre principale de son exposition au musée de l’Orangerie à Paris est une composition en frise de ses peintures d’iPad imprimée sur un papier de 90 mètres de long sur 1 mètre de haut, disposée en U et simplement titrée A year in Normandie.
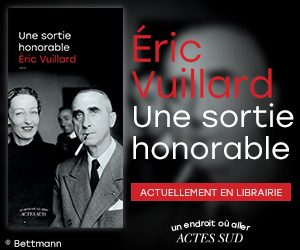
On y retrouve les quatre saisons, les maisons normandes à colombages un peu biscornues du XVIIe siècle, les arbres fruitiers, les rivières, les cabanes, le gui dans les branches, l’humidité, le gel, le gris et les arbres épanouis du printemps. Les couleurs franches et acides explosent sur le long rouleau accroché sur un mur gris foncé, violacé. Les gestes amples d’Hockney, très musicaux, en ligne de force un peu tremblante, font ressembler l’ensemble à un feu d’artifice frais et joyeux.
À l’instar de Michel-Ange, qu’on découvre progresser à la fresque en quatre ans d’un bout à l’autre de son plafond de la chapelle Sixtine, on sent qu’Hockney a gagné en réalisme au deux tiers de son aventure picturale, notamment dans le traitement des cours d’eau, des meules ou de la pluie proche du traitement du peintre japonais Hiroshige.
Hockney a toujours dû se faire une place à part, entre un goût pour la figuration et la pression moderniste de son milieu artistique.
« L’appareil photo voit les choses d’une façon géométrique alors que notre façon de voir est psychologique[2]. » Ce n’est pas tant l’espace qui se déploie devant nous, mais le temps qui passe dans le sens de la lecture de l’hiver à l’hiver de cette année si particulière de confinement dû au Covid. Pour constater l’impermanence du monde des apparences, sa célérité sereine, encore faut-il rester, soi-même, patiemment fixe. C’est la joie des peintres qu’Hockney partage de manière franche et transparente. « Les peintres vivent dans l’instant présent. […] Il faut vivre ici et maintenant. C’est le présent qui est éternel[3]. »
Durant toute sa brillante carrière d’artiste, Hockney a toujours dû se faire une place à part, entre un goût pour la tradition, plus simplement encore pour la figuration, gardant le lien au monde réel, et la pression moderniste de son milieu artistique. Pour rappel, le surpuissant critique d’art de l’école abstraite de New-York, Clément Greenberg déclarait en 1969 à l’occasion d’une exposition de notre anglais de trente-deux ans à la André Emmerich Gallery : « Ce sont là des œuvres d’art qui ne devraient pas avoir droit de cité dans une galerie qui se respecte[4]. »
Hockney a toujours intelligemment questionné son naturalisme ; en jouant tour à tour au naïf ou au primitif italien puis en déconstruisant la représentation classique par la perspective inversée ou la multiplication des focales, mais également en développant des méthodes originales de fabrication des images. « Tu es par essence une île, David. Ton mécanisme se remonte tout seul[5] », lui écrit son amie Ann Graves. De fait, il a réussi à imposer mondialement une œuvre figurative vivante et intime tout le long de période d’abstraction, de minimalisme ou d’art conceptuel. Une gageure.
Artiste vivant le plus cher au monde aujourd’hui (90,3 millions de dollars pour une de ses grandes peintures de 1972), il s’en amuse en citant Oscar Wilde : « La seule personne qui aime toutes les sortes d’art, est le commissaire-priseur[6]. » À 84 ans, il travaille environ 10 heures par jour, assisté de Jean-Pierre Gonçalves de Lima et de Jonathan Wilkinson pour la partie numérique. « Lève-toi et travaille immédiatement », écrivait-il déjà sur un panonceau dans son appartement de Powis Terrace à Londres en 1962. À étudier son parcours artistique, on comprend mieux pourquoi l’arrivée de l’iPad en 2010 était destinée à passionner notre peintre qui l’utilise depuis déjà onze ans.
David Hockney chérit l’économie de moyens : une des salles saillantes de sa rétrospective au Centre Pompidou de 2017, un succès populaire de plus de 600 000 visiteurs, était paradoxalement celle des portraits dessinés les plus simples, datant des années 1970. Utilisant le Rapidograph, un stylo à plume tubulaire technique d’architecte ou d’ingénieur qui dépose élégamment une ligne ultrafine et homogène d’encre de Chine, il s’aventurait avec talent dans la ligne claire et sans filet.
Hockney aime aussi les grands formats spectaculaires englobant physiquement le spectateur, de ses décors de théâtre à sa série du Grand Canyon, jusqu’à son plus grand tableau peint en plein air « Bigger Trees Near Warter » une peinture monumentale, un peu dandy, d’un jour gris dans le Yorkshire, longue de douze mètres et haute de plus de quatre, datant de 2007.
Le protocole de la construction d’image l’a toujours également passionné jusqu’à passer trois années à étudier et écrire Savoirs secrets[7], un livre merveilleux de sensibilité, démontrant le rapport des peintres aux instruments d’optique. Un classique d’atelier, grossièrement décrié par certains historiens de l’Art, l’étude génétique des peintures analysant le processus de création des œuvres, n’étant malheureusement pas encore suffisamment au goût du jour.
Enfin, Hockney a toujours été intéressé par l’évolution des nouvelles technologies. On se souvient de l’un de ses coups de maître pour la Biennale de Sao Paulo de 1989 où il avait voulu faxer un dessin géant en plusieurs parties à son ami commissaire d’exposition Henry Geldzahler. Les lignes téléphoniques brésiliennes n’étant pas assez stables, il envoya les images de son atelier à une chambre d’hôtel de Los Angeles louée pour l’occasion. Un assistant apporta alors les précieux documents au Brésil par avion.
Technologie, économie de moyen, grand format, protocole : l’iPad ne pouvait que s’imposer. Reste qu’en revenant sur son œuvre du musée de l’Orangerie, on ressent un malaise.
Le cartel de l’œuvre indique ainsi « Composition de peintures sur iPad ». Je dois admettre que l’expression « peintures sur iPad », me fait d’abord penser à ces iPad qu’utilisent les peintres dans leurs ateliers, couverts de peinture dans une ambiance à la David Cronenberg entre chair gluante et métal propre. « Peinture ». Cet art de la matière trouve inscrit dans son nom même sa spécificité : une peinture est bien un amalgame de pigments posé sur une surface, de la peinture, une matière qui rêve. Cet objet réel est vraiment différent d’une peinture numérique : une purée de code reproductible.
S’il en fallait une preuve concrète : on retrouve dans l’exposition Hockney au Bozar de Bruxelles « L’arrivée du printemps, Normandie, 2020 » jusqu’au 23 janvier 2022, des morceaux strictement identiques, individualisés, de la frise du musée de l’Orangerie. Il s’agit donc bien en effet à Paris d’une véritable « composition de peintures ».
Le statut ontologique inédit de ce type d’œuvre reste ambigu : les mêmes impressions numériques sont encollées sur métal et encadrées dans une caisse américaine en majesté en Belgique pour être simplement photoshopées entre elles et punaisées au mur en France. Pour un artiste de cette envergure internationale, il est probable que ces tirages de peintures soient également un bon moyen de répondre au foisonnement de demandes d’expositions.
Plus profondément, David Hockney se ravit de la vitesse d’exécution que lui apporte ce médium et de sa capacité à capter la lumière. On le comprend. Il s’agit de passer de la lumière du jour à celle de l’écran rétro-éclairé, deux lumières à synthèse additive, là où l’un des enjeux de la peinture traditionnelle est bien de retranscrire la lumière du jour en lumière à synthèse soustractive : la boue picturale.
À jouer avec l’application « Brushes » qu’utilise David Hockney, on se retrouve très vite à pouvoir parodier sa manière. L’application est d’ailleurs, par manque de mise à jour, un peu désuète aujourd’hui. On peut lui préférer « Sketches » avec plus d’affordance, ou encore « Procreate » qui offre encore plus d’options.
L’application permettant de travailler par calques successifs, les plans de l’espace sont posés les uns sur les autres comme des papiers découpés. David Hockney résout souvent la dureté du passage d’un plan à un autre par des rehauts de petites virgules de points hasardeux plus ou moins transparents. Même si Hockney a plutôt peint ces dernières années alla prima, en une séance de travail, les plans en peinture à l’huile se fondent d’autant mieux qu’ils se frottent physiquement entre eux sur la toile.
À l’iPad, on peut inventer la forme de ses pinceaux : les patterns. Malheureusement dans sa grande composition du musée de l’Orangerie, on retrouve un peu trop fréquemment les mêmes : du pattern demi-flocon/branchage aux grappes de tâches. Il y a le point parfaitement rond, standard, monotone, pour rendre par exemple les pissenlits jaunes. Même l’option dessin proposé par les stories Instagram, sensible à la qualité de pression, semble plus vivante.
Plus étonnant : un motif feuille, un losange légèrement mou, qu’Hockney va utiliser partout, à toutes les échelles, jusque dans le gazon pour faire vibrer une surface. Il perd beaucoup des qualités de ses peintures de la campagne du Yorkshire de 2006, à la touche ronde inspirée de Van Gogh. Le rendu du fourmillement des feuilles est clairement moins vivant sous la raideur appliquée de l’algorithme que dans ses touches crémeuses dansants sur la toile.
La stylisation est volontaire, Hockney est un excellent dessinateur. Pour s’en convaincre, on peut se délecter de ses mains de vieillard feuilletant patiemment un carnet de dessin aux encres Ecoline sur une nappe vichy, dans une vidéo à la limite de l’ASMR en mars 2020.
Montage de peintures iPad produites individuellement au cours de l’année, les passages d’une peinture à l’autre pour donner une impression d’unité sont souvent douteux : un petit paquet de points qui flottent, une plante placée entre deux horizons pour cacher le fait que ceux-ci ne se rejoignent pas… Quelquefois, il assume bizarrement la coupure franche.
Ce tirage de peinture – comme on parle de tirage photographique – possède des qualités propres : une fraîcheur impressionnante des couleurs, une netteté continue, une propreté toute plastique vivifiée par des erreurs de zigouigouis de couleur traînant un peu partout et intelligemment gardées. Elle atteint malheureusement ses limites : l’espace, si important dans l’œuvre d’Hockney, reste ici plat, la matière lasse et, pire, elle imprègne difficilement la mémoire. C’est peut-être aussi une question d’habitude, mais tout comme la lecture d’un livre numérique offre une expérience flottante, une conversation par Zoom, un effet fantôme, il est difficile de reconstruire mentalement cette frise, contrairement aux peintures sur toile d’Hockney qui nous restent à l’esprit.
Enfin, de manière cruelle, par hasard, l’exposition est cernée de chefs d’œuvre d’incarnation picturale : d’un côté les spectaculaires Cézanne de la collection permanente et de l’autre, une exposition temporaire Soutine/De Kooning[8] aux toiles suintantes de sensualité.
La mise à distance du tragique de l’existence par des prothèses technologiques est peut-être un éloignement de cette même existence.
David Hockney ne se considère sûrement pas en fin de partie à 84 ans. Après tout, comme il le souligne dans ses excellents entretiens avec le critique d’art Martin Gayford[9], sa mère Laura est décédée à 98 ans. Reste que l’outil numérique, certes pratique, certes confortable, nous empêche d’avoir accès à ce que peut être parfois la gloire des dernières œuvres d’un peintre.
De Titien à Lucian Freud, de Rembrandt à Picasso, en passant par les Nymphéas de Monet, la fin des peintres est souvent le lieu des derniers éclats, plus libre, sans enjeu narcissique, adapté de manière émouvante au dernier souffle d’énergie. Il est par exemple bouleversant d’épier le dernier jour de peinture de Lucian Freud filmé par David Dawson, son assistant et modèle du jour : on le retrouve humblement contraint par un chevalet réfractaire.
David Hockney a toujours été limpide et généreux dans ses prises de parole, ce qui pourrait donner envie de lui en faire relire quelques-unes. « La photographie domine le monde plus que les langues chinoise ou anglaise ne l’ont jamais fait[10]. » Plus que la photographie, c’est peut-être l’image numérique qui prédomine. Il y a certes cent millions de publications par jour sur Instagram, mais également une industrie du jeu vidéo au chiffre d’affaires dix fois plus important que celui de l’industrie du cinéma. Dans ce cadre, une peinture numérique n’est rien d’autre qu’une image de plus.
Encore Hockney : « Dans une photographie, le temps est le même sur chaque partie de la surface. En revanche, pour la peinture, ce n’est pas la même chose, même s’il s’agit d’un tableau exécuté à partir d’une photographie. La différence est considérable. C’est précisément la raison pour laquelle on ne peut pas regarder une photographie pendant très longtemps. Au fond, c’est juste une fraction de seconde ; par conséquent, vous ne voyez pas les différentes étapes d’un sujet. Lorsque Lucian Freud a réalisé mon portrait, j’ai posé environ cent vingt heures et cela se voit. Chacune des unités de temps a été intégrée dans la peinture. C’est pour cela qu’il est infiniment plus intéressant qu’une photographie[11]. » Dont acte : les peintures d’iPad ne sont pas non plus des empreintes incarnées d’un corps, d’un temps, d’un geste. L’image reste mentale, réversible, on dirait le tirage d’un dessin coloré et finalement, c’est exactement cela.
La peinture, à la différence du trompe l’œil, est un art qui ne fait pas oublier son artificialité dans l’enjeu de la figuration. Il ne s’agit donc pas ici de critiquer le côté factice du protocole de l’iPad, mais bien l’appauvrissement que propose son confort à l’utilisateur.
On touche peut-être ici à la limite de ce que nous offre ce peintre poli, populaire et aimable qui préfère une technique « propre », un résultat spectaculaire et divertissant à une œuvre peut-être plus profonde lié à sa condition d’artiste octogénaire. La mise à distance du tragique de l’existence par des prothèses technologiques est peut-être en effet, un éloignement de cette même existence.
Ainsi Hockney propose une bluette sur les saisons passant invariablement dans la campagne normande. Pourtant l’ère de l’holocène et ses dix mille années de stabilité climatique est derrière nous. Et ce geste simple et généreux d’offrir au regard une année de saison passée acquerra sûrement une vertu documentaire ou nostalgique plus importante que prévue.
« David Hockney. A Year in Normandie », au musée de l’Orangerie jusqu’au 14 février 2022.
