Jacques Rivette, cinéaste nécessaire pour aujourd’hui
Un spectre ne hante pas la cinéphilie actuelle, celui de Jacques Rivette. C’est doublement paradoxal. Paradoxal parce que les spectres, les fantômes sous de multiples formes sont si présents dans ses films – sans oublier ce qu’il appela lui même ses films fantômes, films non tournés mais qui habitent de manière subliminale ceux qui ont été réalisés. Et paradoxal parce que bien des aspects majeurs de notre temps entrent en résonance avec ses films, qui furent à certains égards prémonitoires.
Les spectres sont, selon des modalités très variables, présents dans les vingt longs métrages de Jacques Rivette. Au-delà des leurs rôles particuliers dans chaque fiction, ils sont la traduction d’une haute ambition concernant les puissances de la mise en scène, une affirmation à la fois joueuse et sérieuse, théorique et romanesque, du cinéma comme art de l’invisible. Il se pourrait que le trop grand succès de spectres plus explicites, le si prisé désormais carnaval des monstres et succubes du cinéma d’horreur dont il est devenu obligatoire de ressasser l’éloge, ait contribué à marginaliser ces enchantements plus subtils.
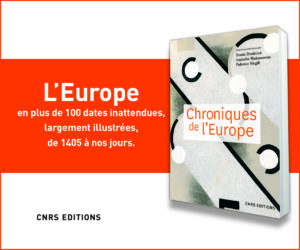
Un des traits habituellement associés au cinéma de Rivette est l’importance des complots : de Paris nous appartient (1960) à 36 vues du Pic Saint-Loup (2009), dans la plupart des films « quelque chose » se trame dans l’ombre. Selon les cas, on en saura plus ou moins, on sera plutôt à proximité des comploteurs, de ceux qui font l’objet de ces manigances, ou dans l’incertitude de la réalité des menées. Et le plus souvent le film organisera une circulation entre ces trois positions, au cours de laquelle se jouent de multiples mystères.
Explicitement inspirée par le modèle des Treize, cette confrérie agissant dans l’ombre qui traverse la Comédie humaine de Balzac, et qui apparaît dans Out One et Ne touchez pas la hache, l’existence de forces occultes – qui sont une autre forme des fantômes précédemment mentionnés – se retrouve dans plusieurs autres films,
