Souvenirs de la mine – sur Le grand mouvement de Kiro Russo
Le grand mouvement, ce pourrait être ce zoom aussi immense qu’interminable qui ouvre le second long métrage de Kiro Russo, mouvement optique qui embrasse La Paz, du grand ensemble au petit détail. Ce rapprochement visuel se double de zooms sonores qui nous font entrer dans les pures sensations de la ville. Le cinéaste bolivien donne dans ce prologue quasi expérimental un portrait rythmique de sa ville, rendant un hommage très contemporain au genre de la Symphonie urbaine très en vogue dans le cinéma muet tardif, et dont le Berlin, symphonie d’une grande ville (1927) de Walther Ruttmann est la plus belle occurrence. Le grand mouvement entre dans la ville comme dans une matière mouvante, vivante, presque perçue de façon abstraite dans des miroirs déformants. En constante métamorphose, la cité est un palimpseste de chantiers où s’abattent des immeubles tandis que d’autres se construisent dans un grand fracas.
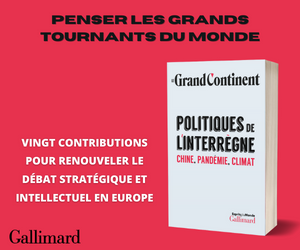
C’est le chant de la ville, dont le réalisateur a prélevé partout des sons qu’il monte comme une partition bruitiste, comme ce gros plan sur la poulie du funiculaire qui débraie redonne du rythme au montage comme à la mélodie urbaine. Dans ce prologue fait de jeux avec les cadres, la ville semble avaler ses enfants, réduits à l’état de petites fourmis qui s’agitent. Le mouvement humain se met à intéresser Kiro Russo dès lors qu’il est social, et, après avoir balayé les façades ou les toits, sa caméra se pose sur le pavé pour porter le message d’une manifestation réelle contre le manque d’emplois. L’un des travailleurs braque son téléphone sur son collègue qu’il filme en l’interrogeant comme s’il était journaliste. Le film s’inscrit ainsi dans une navigation constante entre l’expérimentation formelle et l’ancrage dans le réalisme social. Le regard plein de curiosité sur la ville du prologue est possiblement celui de ces trois ouvriers, qui ont voyagé sept jours depuis leur petite ville d’Oruro pour réclamer que leur travail leur soit rendu.
Prendre la capitale
Le grand mouvement, ce pourrait, évidemment, être aussi cette transhumance qui a conduit Elder et ses deux comparses, mineurs comme lui, jusqu’à Al Paz pour manifester contre la perte de leur emploi. Après une visite guidée de ce monde de rêve et de cauchemar, les trois compères, par désœuvrement ou fatalité, vont s’installer là, et y débuter un semblant d’existence dans une précarité qu’ils vivent avec légèreté. Arrivés en militants dans la capitale bolivienne, les pieds nickelés se font touristes qui en admirent les richesses, se rêvant propriétaires des villas qu’ils survolent en téléphérique jusqu’à un quartier populaire et périphérique, où ils trouvent des emplois de manœuvres presque par hasard. Mais le film de Kiro Russo n’est pas simplement cette histoire d’exode rural et de reconversion forcée d’une classe laborieuse à des journaliers sans statut.
Dans Le Grand mouvement, le fond et la forme dialoguent toujours : les travailleurs participent à l’architecture du plan en transportant des caisses qui vont ouvrir l’arrière plan ou qui viennent au contraire obstruer le champ. C’est la preuve d’une intégrité profonde de cinéaste et d’un souci de se revendiquer comme un artisan tout en offrant aux habitants de ce quartier populaire un portrait d’eux-mêmes auquel ils participent. Ce rémouleur dont on entend le travail avant que de le voir au coin d’une rue pourrait presque être tenu responsable du montage tranchant entre les plans, ou lorsque Elder tombe dans le coma, on pense presque que le vacarme du train filant à vive allure dans la nuit au plan précédent est lié à cette aggravation soudaine de la maladie. L’agencement kaléidoscopique des plans cherche la surprise du raccord, au point qu’on aime à imaginer que le monteur a lancé aléatoirement les prises, formant un patchwork de couleurs et de formes en filigrane d’une narration bien linéaire qui va du centre de la ville à ses faubourgs puis qui recule encore jusqu’à sa forêt.
En tissant ainsi savamment des corrélations entre contenu du plan et forme cinématographique, Kiro Russo instille dans la matière même qu’il filme une dimension politique qui s’ajoute à la scène de contestation sociale d’ouverture. Quand les travailleurs se mettent soudainement à danser, la caméra prend leurs désirs de comédie musicale hollywoodienne pour des réalités et donne de la plongée zénithale pour mieux observer le spectacle, offrant un tour politique en mettant ainsi en scène de façon grandiose des corps qui s’ensauvagent joyeusement au beau milieu de leur travail nocturne de manutention.
Seul Elder, fatigué par cette semaine de voyage à pied et par le manque d’oxygène des hauteurs de l’Altiplano andin, manque chroniquement d’énergie. Il suffoque, se déplace au ralenti, jusqu’à ne presque plus pouvoir avancer, sans cesse poussé ou soutenu par ses amis inséparables, Galo et Gato. Elder est un corps burlesque qui reprend le projet éminemment social du genre à ses débuts, tel que porté par Chaplin ou Fatty Arbuckle. Il tombe, peine, s’effondre d’épuisement partout où il peut, traduisant physiquement et malgré lui un manque de vitalité qui est la faute suprême dans une société capitaliste de l’efficience, de la productivité et du résultat. Tous ceux qui le croisent conjecturent sur cette étrange narcolepsie qui frappe ce petit corps trapu : paresse pour un patron qui refuse de lui payer sa journée de travail parce qu’il est trop lent ; stress et anxiété pour un médecin de l’hôpital où il atterrit après un malaise ; possession satanique pour une vieille femme bienfaisante qui se prétend sa marraine mais qu’il dit n’avoir jamais vue.
Marxisme magique
Après avoir été le corps en trop, Elder devient, avec ce coma, une âme ensommeillée qui se retire du décor pour mieux reprendre le pouvoir sur la narration, lui imposant ses cauchemars, comme dans ce rêve de la mine, où les boyaux ne sont éclairés qu’à la lampe frontale des ouvriers, et où les chaînes qui servent à remonter le charbon à la surface s’agitent jusqu’à la démesure d’un montage soviétique. S.M. Eisenstein n’aurait justement pas renié le raccord abrupt qui vaut pour métaphore : la séquence suivante, qui nous propulse au marché, s’ouvre par un mixeur qui laisse sortir de la chair à pâté, image crue et violente qui assimile les corps ouvriers à de la viande que l’on broie et amalgame.
Kiro Russo revendique pour son film un héritage soviétique, mais davantage celui de Dziga Vertov, le pionnier du cinéma bolchévique décrivait ainsi le cinéma qu’il préférait appeler appelait Kino-Pravda (ciné-vérité) : « le Kino-pravda est fait avec le matériau comme la maison est faite de briques. C’est de la manière dont nous allons laisser la vie pénétrer dans l’objectif que dépendent la qualité technique, la valeur sociale et historique du matériau et ultérieurement la qualité de tout film. Mes contempteurs ne pouvaient se passer, par la force de la tradition, de textes de liaison entre les sujets » écrivait le réalisateur qui s’identifiait tant à son outil de travail qu’il s’était rebaptisé d’un pseudonyme signifiant « Toupie qui tourne ».
Dans Kino-Glaz, il ose toutes les expérimentations pour montrer le réel tel qu’on ne l’a jamais vu : attachant son appareil à l’avant d’un tramway en mouvement ou directement sur les rails, le plaçant à 90 degrés de la route, ou faisant même les premiers essais de caméra cachée pour saisir au mieux les expressions sur les visages du peuple soviétique qu’il aimait tant. Ce documentaire tourné en Union soviétique en 1924 raconte l’histoire de la classe prolétaire depuis la ville où on équarrit les bœufs pour les manger jusqu’à la campagne où on l’a préalablement élevé. C’est bien du côté de cette figure paternelle qu’il faut chercher la synthèse des deux films qui cohabitent dans Le Grand mouvement : l’ode à la grande ville et la comédie sociale. Comme lui, le Bolivien accrédite la croyance que le cinéma est un matériau concret, pierres de sons et d’images, mais aussi qu’il permet de mieux voir le monde.
Mais là où Kiro Russo s’éloigne de ses camarades soviétiques, c’est en faisant entrer en scène le personnage de Max, sorte de HD Thoreau des Andes, qui concocte des potions reclus dans une cabane au fond des bois. Les touches de fantastique qui s’insinuaient progressivement dans le récit à mesure qu’il était gagné par l’obscurité des faubourgs mal éclairés et des shifts nocturnes de manutention prennent un véritable tournant magique dès l’apparition de ce vagabond. Ses incantations semblent revêtir davantage de force quand, dans le mitan du film, un grand chien prend son élan au cœur de la forêt et vient terminer sa course face au spectateur. Ce messager pourrait sortir tout droit de la jungle thaïlandaise filmée par Apichatpong Weerasethakul lorsqu’il halète dans la demi-obscurité que sa blancheur extrême semble éclairer comme une lune. Est-il cette force surnaturelle que Max convoque par ses potions incantatoires ? Sa présence fait indéniablement basculer le récit dans un versant surnaturel et mental.
Dans Viejo calavera (2016), le premier long métrage de Kiro Russo, Julio César Ticona (Elder) interprétait son propre rôle dans la mine de Huanuni où il travaillait réellement. Le grand mouvement semble refaire à rebours l’histoire de son personnage : de la ville au retour à la mine, fût-il imaginaire. Son corps est certes à l’arrêt, affaibli, presque mort. Mais c’est son esprit qui va prendre le contrôle du film dans cette hallucinante séquence de cauchemar qui rejoue tous ses traumas, les accumulant, les accélérant, jusqu’à rendre le montage totalement fou. Ce songe va jusqu’à lui faire cracher ce qui a accablé son organisme d’une inanition prématurée : la fatigue, l’angoisse des couloirs de la mine, la silicose qui attaque ses poumons… Le cinéma est un rêve et la vie juste un souffle. Le trajet retour de la mort à la vie, c’est certainement avant tout cela, le Grand mouvement du titre.
