Douleurs, anti-douleurs et stupéfaction – sur Ghost Song de Nicolas Peduzzi
Ghost Song, c’est Houston, aujourd’hui : dans le film semi-écrit, semi-documentaire de Nicolas Peduzzi, c’est en particulier à travers trois de ses habitant·es que nous appréhendons la ville, et plus largement à partir de cet ancrage, la tempête civilisationnelle qui balaie l’ensemble de la société américaine. Ghost Song montre Houston dans l’alerte permanente d’un ouragan annoncé, métaphore de la crise sociétale qui n’a pas su être évitée et dont la révélation ne se fait qu’au fil des dégâts irréversibles constatés sur son passage.
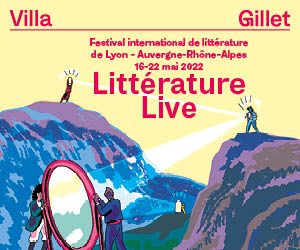
Nous accompagnons d’un côté Alexandra (OMB Bloodbath de son nom de scène), jeune rappeuse noire, couverte de tatouages, de l’autre Will, William Folzenlogen, le rejeton toxicomane et déshérité d’une riche famille blanche et son ami Nate Nichols. Mais ces deux côtés ne se croisent jamais tout à fait. C’est à la fois que les milieux sont différents (séparés en premier lieu par la couleur de peau, et toutes les institutions qui s’y articulent : églises, économie, milieux professionnels, quartiers et rues), et que la ville est assez grande pour générer ces poches d’invisibilité où l’on perd facilement trace des un·es et des autres, où l’on demeure seul·e au sein même de la société.
Tout est cependant lié : Bloodbath d’une part et Will et Nate d’autre part ne sont pas des fictions, ce sont trois personnes réelles et vivantes, et trois nœuds dans la toile urbaine complexe de Houston. Trois crispations vivantes dans un même décor. Et c’est au sens large qu’il faut entendre ce cadre, qui n’est pas seulement spatial, mais temporel : l’architecture, l’immobilier, le visage de la ville qui se donne jusque dans les façons de bouger, de parler et de se vêtir des gens. À fleur de peau, les corps sont l’extrême surface d’une longue histoire qui n’a pas fini de se décanter.
Stay out of the hood ou quand rien de bon ne se présage au-dehors
OMB Bloodbath compose, interprète ses textes, et élève avec sa copine le petit garçon de celle-ci. Elle jo
