Résonance poétique – à propos de Celui qui veille de Louise Erdrich
En lieu et place de Celui qui veille, titre du dernier roman de Louise Erdrich, lauréate du prix Pulitzer 2021, on pourrait penser que c’est plutôt elle qui veille au grain depuis plusieurs décennies : au grain de la voix amérindienne dont elle est l’une des plus célèbres représentantes, quoique ses origines soient mixtes, ojibwées mais aussi allemandes, canadiennes, qu’elle ait été élevée dans la religion catholique et qu’elle soit allée à l’université en Nouvelle-Angleterre.
Aussi ses connaissances du monde, de la culture et de la langue amérindienne sont-elles souvent indirectes, livresques voire universitaires même si ses parents enseignaient dans une école régie par le Bureau des affaires indiennes et qu’elle a grandi dans le Dakota du Nord qui comprend la réserve indienne de Turtle Mountain, sur laquelle vécut son grand-père et qui donne un cadre à ce récit.
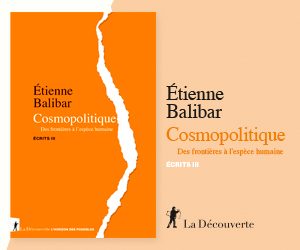
Pour comprendre l’histoire, il faut se référer à la postface d’Erdrich qui nous informe que son aïeul présidait le « conseil consultatif de la Bande d’Indiens Chippewas de Turtle Mountain » dans les années 50 et qu’il se battit contre la loi de « termination », terme heureusement éclairé par la traductrice dans une note d’introduction. Parfois traduit par « politique d’assimilation », « rupture », « cessation de tutelle » ou « liquidation des tribus », le mot désigne la suppression des tribus comme « entités collectives », ayant une « relation particulière » au gouvernement fédéral et leur reconnaissance comme « citoyens américains à part entière, avec les droits et obligations afférents ».
Dans sa postface, Erdrich dépeint cette « termination » comme un « désastre » ayant causé la perte de 570 000 hectares de terres et un dénuement total pour les tribus qui n’en tirèrent aucun bénéfice. Le livre rend donc hommage au combat mené par le fameux grand-père pour « se dépêtrer du long cauchemar que fut la termination » : un lointain souvenir des années 50 et 60, pourtant remis au goût du jour par l’ad
