En reconstruction – sur Revoir Paris d’Alice Winocour
Lorsque Alice Winocour a commencé à tourner Revoir Paris dans lequel Mia (Virginie Efira), échappe à un attentat en plein cœur de la capitale, le procès des attentats du 13 novembre 2015 était en cours sur l’île de la Cité. La municipalité a alors demandé à l’équipe de signaler distinctement qu’il s’agissait d’un tournage afin d’éviter que toute confusion avec un fait actuel ne heurte des badauds. Ce détail dit combien la fiction et le réel se trouvent entremêlés dans le quatrième long métrage de la réalisatrice, mais aussi à quel point l’émotion de l’événement reste intimement attachée à cette ville. Pendant onze mois d’audience bouleversés par le Covid, le procès a jugé 20 accusés, dont 19 ont été reconnus coupables des charges qui pesaient contre eux.
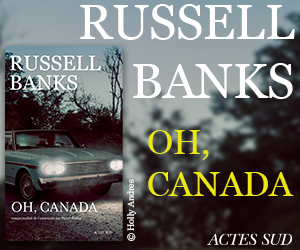
Plus près des événements, le témoignage d’Antoine Leiris intitulé Vous n’aurez pas ma haine, offrait une confession à cœur ouvert du mari d’une victime. De ce récit intime sortira en novembre au cinéma une adaptation par Kilian Riedhof.
Le documentaire 13 novembre : Nec mergitur de Jules et Gédéon Naudet réalisé en 2018 opère, lui, la reconstitution, via le récit des témoins directs de l’événement, de la chronologie des faits de cette nuit sanglante. Un montage chronologique serré des personnes présentes sur les lieux des attentats jouant pleinement sur l’émotion de l’identification.
Travail d’équipe
Si la temporalité de la justice et celle du cinéma se rencontrent près de sept ans après les faits, c’est qu’il leur a fallu prendre le temps de l’enquête. Sortent donc à quelques semaines d’intervalle Revoir Paris et Novembre de Cédric Jimenez (le 5 octobre) présentés au dernier Festival de Cannes (respectivement à la Quinzaine des réalisateurs et Hors compétition).
Tous deux placent le théâtre des événements en hors champ pour se concentrer sur la reconstitution de l’investigation qui y succède. Enquête policière pour Novembre qui s’installe dans les locaux de la SDAT (Sous-Direction Anti-Terroriste) et nous plonge en apnée dans l’effet tunnel des cinq jours et cinq nuits durant lesquels il s’agit de remonter la piste de l’élaboration des attaques à partir de l’alerte de la première explosion au Stade de France. Jimenez s’appuie sur une documentation très précise rassemblée par le scénariste Olivier Demangel et insiste sur l’effet de corps que produit la responsabilité de travailler sur cet événement inouï.
La démarche d’Alice Winocour est tout autre, elle qui fut touchée personnellement par les attentats du 13 novembre 2015 et a mûri le projet d’un film choral autour de personnages unis par le drame d’une attaque terroriste qui ressemble au 13 novembre sans l’être. Elle a longuement lu les forums, rencontré les rescapés et les proches de victimes autant qu’analysé la façon dont son propre souvenir de l’événement se modifiait au cours des mois ainsi que celui de son frère présent au Bataclan ce soir-là.
Dans Revoir Paris, l’enquête est intime, mais tournée vers l’intime du deuil et de la résilience : après une longue période d’isolement, Mia découvre en rentrant à Paris qu’une association de victimes se retrouve régulièrement sur les lieux pour aider chacun à réorganiser sa chronologie personnelle. « Il faut être plusieurs pour se souvenir », lui dit Sara qui dirige ces réunions.
Nuances de l’oubli
Mia a tout oublié de ce qu’elle a vécu lors de la fusillade de masse dans une brasserie où elle s’était arrêtée seule pour attendre la fin d’une averse. En devenant l’enquêtrice de sa propre mémoire, elle rencontre toutes les nuances de l’oubli incarnées par une cohorte de victimes ou de proches qui fait société par la force des choses.
Revoir Paris se pose la question de la légitimité de la fiction à rejouer les émotions vécues. Quoiqu’inscrits dans la trame d’un attentat imaginaire, les récits des personnages secondaires sont fidèles à ceux que la réalisatrice a entendus ou lus. Elle dose avec une infinie délicatesse l’émotion qui traverse le film, réservant les éléments les plus poignants aux personnages secondaires, mais se refusant à la facilité de plier la fiction à tout pathos.
Les deux protagonistes se situent aux extrémités du spectre : Mia, elle, ne ressent rien parce qu’elle a tout oublié. L’épais blouson de motarde dans lequel elle traverse la ville lui fait une carapace. Thomas, interprété par Benoît Magimel, se souvient de tout et atténue ses affects avec l’humour du désespoir. Corps souffrant, il impose l’ironie pour éviter de susciter la détresse. La réponse d’Alice Winocour est donc de dessaisir les personnages joués par des acteurs stars de leurs émotions pour éviter l’obscénité que le jeu pourrait recouvrir.
Cédric Jimenez se pose lui aussi cette question de l’incarnation de faits réels mais y répond différemment, en ajoutant une couche de mise en abyme au récit policier. Dans le portrait de groupe avec fonctionnaires irréprochables que fait Novembre, le patron Jean Dujardin domine la brigade de son autorité naturelle tout autant que le casting qui reproduit une hiérarchie identique à celle de la police, de l’acteur gradé au rôle subalterne. Le film entier se construit autour de situations empruntées au monde du travail bien plus qu’au genre du polar. Il s’ouvre sur une réunion de motivation des troupes, passe par un entretien de recadrage de la jeune recrue jouée Anaïs Demoustier qui, à vouloir trop bien faire ne respecte pas les procédures, et se clôt par un discours général de congratulation. La galvanisation face à l’aspect hors norme des faits conduit à une apologie du travail d’équipe et celui de la hiérarchie.
On peut percevoir une réponse aux critiques émises à l’encontre de Bac Nord, tout en y voyant une façon de mettre en parallèle le travail d’équipe qu’impose le cinéma et celui des superflics.
De la communauté policière émerge la satisfaction de l’enquête menée à son terme et la neutralisation des suspects. Dans Revoir Paris, ce qui ressort dans cette communauté de circonstance, c’est ce que les psychiatres appellent le « diamant dans le trauma ». Des solidarités puissantes naissent de ce vécu commun par delà les origines sociales.
Mia noue un lien maternel avec Felicia dont les parents en vacances dans la capitale, ont succombé à l’attaque. De ce jour funeste, la très jeune femme a reçu la carte postale qui lui était destinée comme souvenir et qui représente un détail des Nymphéas. Au musée de l’Orangerie, Mia et Felicia cherchent sur le mur peint par Claude Monet le détail qui figure sur la carte retrouvée dans les affaires des défunts. Il importe qu’elles soient ensemble pour regarder ensemble la dernière chose belle que le couple a vue avant de mourir. La mémoire est un puzzle qu’il faut reconstituer à plusieurs, en cherchant le motif dans le tapis.
Refilmer Paris
Revoir Paris, cela veut dire pour Mia regarder à nouveau le lieu du drame en face. Elle y revient comme un fantôme, que Virginie Efira joue sobrement, en peu de mouvement et peu d’expressions. Son visage semble absent, traversé par des sentiments contraires : le sourire qu’affiche sa bouche est contredit par la tristesse de son regard.
En traversant Paris en moto, à la recherche d’éléments factuels qui pourraient l’aider, elle s’engouffre dans des tunnels qui sont comme autant de tentatives de passages du pays des morts à celui des vivants. Le tout premier plan du film fixe la ville depuis son appartement en étage élevé. L’objectif zoome sur les toits, la faisant sortir du champ. Le mouvement du film s’articule entre les sous sols et les cimes de la capitale : pour retrouver ses souvenirs, Mia doit parcourir la ville de son trauma.
« Paris est une ville qui a toujours occupé une place particulière dans mon cœur ». En direct à la radio, Mia qui est interprète traduit du russe cette phrase – l’une des premières du film – prononcée par un metteur en scène venu monter une pièce en France. Elle ne sait pas encore que son trajet des mois suivants va consister à se l’approprier afin de retrouver sa place dans le décor.
On devine qu’elle est aussi une pensée de la réalisatrice qui a grandi dans la capitale mais ne l’avait jamais filmée jusqu’alors et se confronte à des décors mille fois vus au cinéma. Elle choisit de montrer les traces de la tragédie : les bougies commémoratives rassemblées sur les trottoirs comme le bruit ininterrompu des ambulances qui reste lancinant des mois après les événements. Mais aussi, paradoxalement, l’effacement de cette tragédie.
Les plans de la ville ont été tournés par Blaise Harrison et non par le chef opérateur Stéphane Fontaine. Rompu aux tournages documentaires, le cinéaste franco-suisse balade une caméra portée dans des rues dont la circulation n’a pas été interrompue. Alice Winocour filme les différents visages de la ville : la face historique, ses quartiers touristiques tout comme ses coins populaires.
Quand Mia se rappelle qu’un cuisinier lui a tenu la main en attendant l’arrivée des secours, elle part à sa recherche dans les arrières cuisines des kebabs de la Porte de la Chapelle. Pour le personnel sans papiers qui travaillait dans le restaurant, ce drame s’inscrit dans une succession d’épreuves : une réalité économique ou politiques qu’ils ont dû fuir, le voyage périlleux qu’ils ont fait jusqu’à la France. L’attentat les condamne à tout reprendre à zéro. Mais pour eux, cela n’est pas la première fois.
Corps fantômes
La beauté de Revoir Paris est de faire des éclats de la mémoire fragmentée de Mia une matière cinématographique. Lors d’une représentation à l’opéra, les cris de la cantatrice font résonner la survivance des hurlements de la brasserie. Le crépitement des bougies pour l’anniversaire de son compagnon joué par Grégoire Colin fait ressurgir dans l’esprit de Mia le bruit identique entendu juste avant les rafales des armes automatique.
Mia subit les assauts de flash back, qui font effraction dans sa conscience comme si elle était spectatrice de sa propre mémoire et qui se confondent avec sa réalité. La musique bruitiste de la compositrice suédoise Anna Von Hausswolff constitue l’étoffe de ce bourdonnement qui occupe constamment la pensée du personnage. Le montage tisse de ces correspondances des effets sensoriels qui s’impriment chez le spectateur, créant une mémoire sensible des événements auxquels il a assisté en ouverture, comme le bruit de l’eau qui intervient à plusieurs reprises mais sous des formes différentes (une averse, un ruissellement ou le cours de la Seine).
C’est aussi par le son que la réalisatrice donne des signes prémonitoires du drame. Un verre que Mia brise sur le carrelage avant de partir travailler le matin même, un homme qui se cogne près d’elle contre une vitre et la fait sursauter, le téléphone de son compagnon la surprend en vibrant sur la table. Ces avertissements relèvent du pur code du cinéma de genre et s’adressent autant au spectateur qu’au personnage.
Il y a effectivement au sens propre quelque chose de purement horrifique dans le récit de ces corps fracturés pris dans des limbes, traversant une vie qui n’est plus tout à fait la leur, un décor dans lequel ils ne s’implantent plus vraiment, une vie familiale à laquelle ils n’appartiennent plus. Quand Mia rend visite à Thomas à l’hôpital, son corps traverse les couloirs comme une ombre sans substance. La prothèse métallique de Thomas rappelle Crash de David Cronenberg bien plus qu’elle n’évoque avec exactitude l’état actuel de la chirurgie orthopédique. Par ces détails, Alice Winocour prend du champ par rapport à la rigueur réaliste de ce son récit et fait de ses personnages des body snatchers d’eux-mêmes, deux spectres en reconstruction.
L’idée d’un corps machine survient aussi de façon surprenante dans la voix off : « On nous appelle les photocopieurs » dit Assane, le cuisinier rescapé de la brasserie. Ce surnom désigne la capacité des cuisiniers maliens et sri lankais à reproduire avec exactitude les recettes qu’on leur donne. Si le terme vient nous interpeller, c’est que cette qualité de perfection de duplication artisanale désigne précisément ce dont la mémoire humaine n’est pas capable.
Les événements, leur chronologie, leur signification ne sont pas imprimés dans l’esprit de ceux qui les ont vécus. Alors que Mia et Thomas discutent dans la rue, un couple de mariés vient se mettre entre eux à l’arrière-plan, induisant la romance qui point sous leur complicité de suppliciés et la possibilité de renaissance que leur offre leur rencontre. Lorsque la jeune femme propose de s’incruster à la fête, Thomas rechigne en raison de sa claustrophobie avant de rendre les armes. « On est des fantômes, personne ne nous remarquera », concède-t-il avant d’entrer. Sur la piste, leurs corps cherchent la mémoire de la joie de danser. L’épaule de Mia est prise d’un tressaillement saccadé, comme les zombies du clip de Thriller. Ce sursaut de joie dans un corps qui semblait anesthésié semble être le premier révélateur que Mia est une survivante.
