Autopsie de l’innocence – sur Taormine d’Yves Ravey
Les narrateurs d’Yves Ravey ne sont pas exactement recommandables. Sortes de failles ou de bouches d’ombre, consciences masculines qui se mentent à elles-mêmes. Voilà qui est on ne peut plus raccord avec le genre que Ravey pratique : le polar. Par exemple, dans Sans état d’âme (2015), c’est le meurtrier qui raconte, après nous avoir annoncé son forfait page 17. Dans Adultère (2019), le narrateur se dit plein d’un « projet criminel ». Cela oblige évidemment à fignoler le point aveugle du récit, si l’on veut que la fiction fonctionne. On a pu dire que Ravey était une sorte de Simenon passé par le Nouveau Roman. On ne croit pas que Simenon ait beaucoup pratiqué le First Person Shooter. Mais les âmes marécageuses, oui. On sait que Simenon avait beaucoup appris de Dashiell Hammett. Les protagonistes de Taormine s’appellent Melvil et Luisa Hammett. Notre méconnaissance de Dashiell, hélas, ne nous permet pas de dire si la plaisanterie s’arrête là ou non. Quant à « Taormine », à part le nom de la ville, on n’a pas trouvé beaucoup d’autres pistes qu’une anagramme : « aimeront ».
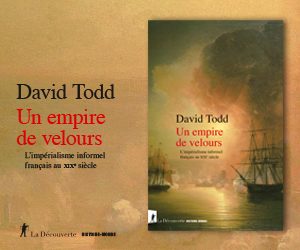
Quelque chose a disparu dans Taormine, comme dans tout bon roman policier, et c’est en l’occurrence notre vigilance : « Un couple au bord de la séparation s’offre un séjour en Sicile pour se réconcilier. À quelques kilomètres de l’aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture de location percute un objet non identifié. Le lendemain, ils décident de chercher un garage à Taormine pour réparer discrètement les dégâts. Une très mauvaise idée. » Ainsi le livre est-il présenté au public.
L’important, bien sûr, c’est qu’on oublie au fil de la lecture le choc et l’objet non identifié, comme Melvil, le narrateur, voudrait l’oublier. Pour cela, il faut noyer l’instant de l’accident dans une mer de notations sensorielles et atmosphériques, dans un souci au bord, comme on nous le dit, de la rupture : Luisa et Melvil, qui ont quelques soucis d’adultère, vont-ils passer le cap de ces vacances ? Voilà co
