Film Opportunisme –
à propos de Sans Filtre de Ruben Östlund
Le 28 mai 2017, Pedro Almodovar, président du jury du festival de Cannes, remettait la Palme d’or à Ruben Östlund pour The Square. Le cinéaste suédois touchait le gros lot dès sa première participation en compétition, prix qui se refuse depuis des décennies au cinéaste espagnol, malgré sa cote d’amour publique et sa reconnaissance critique sans commune mesure. Certes, les palmarès sont faits pour être discutés à l’infini et Almodovar est libre et souverain dans ses choix. Toujours est-il que voir la générosité almodovarienne récompenser le ricanement östlundien donnait l’impression d’une distribution des prix effectuée dans le mauvais sens et provoquait un certain pincement au cœur.
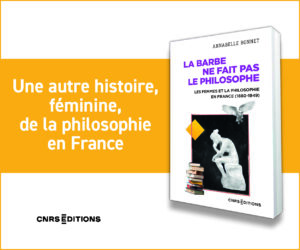
Le 28 mai 2022, cinq ans plus tard jour pour jour, Ruben Östlund recevait la même récompense pour Sans Filtre, l’intronisant au club hyper sélectif des doubles palmés.
Perseverare diabolicum !
Alors que Sans Filtre arrive aujourd’hui sur nos écrans, il est difficile d’en parler comme d’un simple film, fût-il « de prestige ». C’est aussi le type de cinéma que Cannes – en tant qu’aiguillon mondial des tendances et des modes de production – s’est choisi comme emblème. Un choix pour le moins ambigu. De toutes les récentes Palmes d’or, c’est le film le plus intrinsèquement lié à l’écosystème cannois. Alors oui, bien sûr, il faut commencer à parler du film, mais il faut aussi mentionner la stratégie de reconnaissance bien orchestrée dont il se cache à peine.
Et garder à l’esprit que le film que nous voyons aujourd’hui n’est finalement que le reflet de sa projection au Grand Théâtre Lumière du samedi 21 mai dernier, laquelle se voulait un happening endimanché et au bout du compte inoffensif.
Sans Filtre est découpé en trois chapitres (une crise de couple, une croisière catastrophe, une possible reconstruction) et obéit à une dynamique d’effet papillon. Comment un incident au sein d’un jeune couple provoque rien de moins que le naufrage de la civilisation du luxe.
Carl et Yaya, couple
