Une révolution – sur l’exposition Fela Anikulapo Kuti à la Philharmonie
«Je suis né deux fois ». Ainsi débute le chapitre 2 de Cette Putain de Vie, l’autobiographie de Fela Kuti publiée aux éditions Khartala en 1982 (et jamais rééditée depuis). « Ma première naissance remonte à 1935 » poursuit-il. À l’époque, le Nigéria est encore britannique et pour complaire aux autorités coloniales le père demande de choisir le prénom de l’enfant à un missionnaire qui propose… Hildegarde. « C’est vous dire à quel point j’étais désiré !» ironise Fela. « Moi qui étais venu sur terre défendre la cause africaine, j’allais devoir me coltiner le prénom d’un oppresseur européen ! »
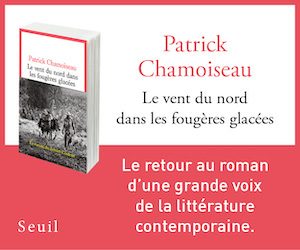
Finalement Hildegarde meurt au bout de deux semaines. Une mansuétude des Dieux désireux de lui épargner cette énième humiliation selon Fela. C’est que le nom des Kuti est déjà associé à celui de Ransome, attribué à son grand père par un autre missionnaire blanc, le père Ransome, qui a financé son voyage à Londres pour enregistrer des chants religieux. C’est ainsi qu’en 1925, la compagnie EMI sort quinze 78 tours du Révérend Canon J.J. Ransome Kuti, pionnier de la Yorouba Christian Church. Le mystère de la migration des âmes aidant, celle d’Hildegarde finit par retrouver enveloppe charnelle plus endurante le 15 octobre 1938 à Abeokuta, fief des Kuti. Voilà pour la seconde naissance.
Il en est une troisième qui, bien qu’elle échappe aux mystérieuses lois de la métempsychose, ne peut être négligée alors que s’ouvre à la Philharmonie de Paris une exposition consacrée au père de l’Afro Beat[1]. Plus proche de la chrysalide, elle consacre ce moment où le jeune trompettiste diplômé du Trinity College of Music de Londres, qui chaque week-end s’acquitte avec les Koola Lobitos d’un sympathique High Life jazz dans les clubs de Lagos, se métamorphose en rebelle messianique qui dénonce les injustices, la corruption, l’héritage colonial et voue aux gémonies une élite qui dilapide les richesses du pays (5ème producteur mondial de pétrole) et laisse croupir son peuple dans une indescri
