Pour saluer encore Melville – à propos de la traduction de ses Poésies
Melville trône tout en haut de notre petit panthéon autant par la bénédiction des livres qu’il a écrits que par la malédiction qui lui aura collé à la peau. Il est bon de le rappeler. Aujourd’hui, la parution de l’intégralité de ses poèmes – à l’exception de Clarel – suffit à en faire un événement éditorial.
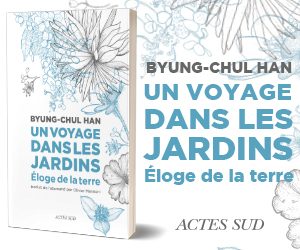
Pour saluer Melville est un bref et magnifique récit de Giono. On y voit un Melville « d’un mètre quatre-vingt-trois, avec soixante-sept centimètres d’épaules », on le découvre la tête embaumée et on admire pourquoi « j’aimais beaucoup la tendresse timide de son cœur forcené ». Giono l’envisage comme une sorte de postface à Moby Dick, dont il vient d’achever avec Joan Smith et son ami Lucien Jacques la première traduction en français. Et il l’écrit à sa sortie du fort Saint-Nicolas où il a été emprisonné quelques semaines pour des écrits d’un pacifisme dissonant et malvenu. C’était en novembre 1939, la guerre avait recommencé en Europe avec ses logiques désastreuses, ses visées impérialistes et sa part de poker menteur.
Bien entendu, on doit aussi saluer la traduction de Thierry Gillybœuf, la joyeuse énergie qu’il fallut pour batailler avec la nappe des mots et les assonances. Ses trente pages d’introduction constituent une excellente présentation qui nous mène au bord du plongeoir pour sauter dans le grand bain. Elles donnent également une idée de la part respective du roman, de la nouvelle et de la poésie dans son œuvre et nous montrent ainsi que la poésie y a la part belle. Melville n’a rien d’un aimable poète du dimanche. Gillybœuf en fait même très justement le troisième volet d’un triptyque Whitman-Dickinson-Melville qui donne à la poésie américaine ses bases et rend d’autant plus étourdissant son renversement objectiviste au XXe siècle.
Tableaux et aspects de la guerre est le premier et long ensemble de poèmes de ces Poésies. Que ce volume paraisse alors qu’une guerre a commencé à nouveau en Europe tient du hasard mais ne laisse pas indifférent.
