De quoi y a-t-il histoire ? – sur « Thomas Demand, le bégaiement de l’histoire »
L’anecdote est connue : le 2 août 1914, Kafka consigne dans son journal un lapidaire : « L’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi piscine ». La distance qui sépare ces deux phrases semble infranchissable ; même, elles paraissent se tourner le dos l’une l’autre. L’énoncé exprime ainsi cette espèce de virtualité dans laquelle évoluent les géants de l’Histoire, « l’Allemagne », « la Russie », et d’où ils l’écrivent ; à quoi s’oppose l’immédiateté du loisir, la piscine, activité première — et un peu bête — du délassement.
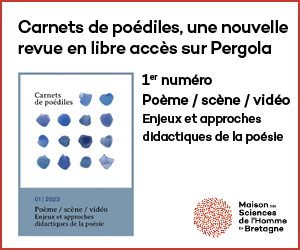
C’est cet écheveau entre le monde vécu, l’actualité et l’histoire que démêle, jusqu’au 28 mai, au Jeu de Paume, l’exposition consacrée à l’œuvre du sculpteur et photographe allemand Thomas Demand. Les œuvres de celui-ci constituent autant de variations autour d’un même mode opératoire : Demand fabrique d’abord des maquettes en papiers et en cartons représentant un décor, sans présence humaine, qui se rattache de près ou de loin à un événement historique. Puis, l’artiste photographie sa maquette avant de la détruire pour n’en conserver que l’image, dont des tirages chromogènes sont exposés.
Le procédé réalise une double mise à distance. D’abord, il inspire au visiteur du musée, confronté aux images, une impression d’« inquiétante étrangeté[1] », terme déjà beaucoup convoqué pour parler du travail de Demand[2]. Ensuite, il introduit un second écart entre la scène représentée et l’événement historique auquel elle fait référence : celui-ci se trouve à peine suggéré, tout juste prête-t-il son contexte à la scène. La clarté de la référence intéresse finalement moins Thomas Demand que les lignes d’horizon de nos paysages visuels, celles qui organisent les collections d’images, surabondantes, en Occident — de là le sentiment indissipable de déjà-vu dans une exposition qui fait tourner notre cinéma intérieur dans le vide.
Quelle inquiétante étrangeté ?
Si cette étrangeté nous inquiète, c’est d’abord parce qu’elle froisse un tissu de cho
